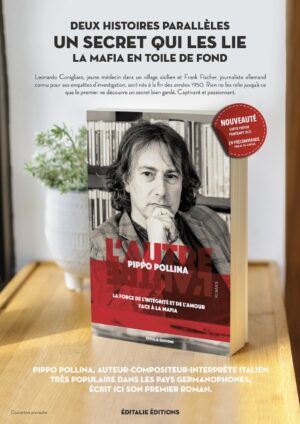Nous ne cesserons jamais de commémorer leur exemple. Giovanni Falcone et Paolo Borsellino sont deux Italiens, deux Siciliens qui ont incarné ce moment historique précis où l’Italie pouvait aller dans le sens contraire du système mafieux et changer, enfin, son visage. Certains en ont décidé autrement. Lorenzo Tosa nous rappelle, à l’occasion du trentième anniversaire de la mort des deux juges, ce tournant manqué et la solitude irresponsable dans laquelle l’État a laissé deux des plus clairvoyants et lucides serviteurs de la vérité.
Giovanni Falcone commença à mourir ce jour de la fin du mois de septembre 1991 lors duquel il fut visé dans le dos par le feu ami. Il était assis sur une banquette rouge, devant les 592 personnes qui remplissaient le teatro Parioli de Rome et les plus de 10 millions d’Italiens collés à leur télévision, chez eux. Ce soir là, Maurizio Costanzo [célèbre journaliste et présentateur de la télévision italienne, ndr], à l’occasion d’un marathon télévisé, aurait dû envoyer un message transversal de résistance à la mafia, à la suite de l’homicide brutal de l’entrepreneur anti-pizzo Libero Grassi. Pour ce faire, Costanzo, qui était un bon ami de Falcone, avait voulu à ses côtés ce magistrat palermitain à la moustache chevron qui avait accepté, seulement quelques jours auparavant, du ministre de la Grâce et de la Justice Claudio Martelli la proposition d’aller diriger à Rome la section Affaires Pénales du Ministère. Beaucoup, en Sicile, ne le lui pardonnèrent pas. Et parmi eux, il y avait aussi un avocat de 51 ans aux moustaches épaisses comme les siennes et aux yeux exorbités qui s’appelait Alfredo Galasso et qui était assis, ce soir là, ironie du sort, juste au-dessus de lui, sur un petit divan Art Nouveau, tel un corbeau juché sur son perchoir.
« Giovanni Falcone, selon moi, vous feriez bien de quitter le plus vite possible votre poste au Ministère parce que l’air là-bas ne vous fait pas du bien, et même pas de bien du tout », attaqua Galasso.
« C’est une opinion subjective, et elle signifie une absence de sens de l’État », fut la réplique du juge, avant l’estocade finale.
« Giovanni, je n’aime pas que tu sois dans le Palais du gouvernement. »
C’était un dialogue surréaliste, avec Falcone contraint de répondre à des insinuations infâmantes en tournant le dos, sans même pouvoir regarder en face son accusateur. À le revoir aujourd’hui, avec la juste distance, ce n’est que la représentation plastique de ce qu’a été Giovanni Falcone au cours des 1 068 jours qui ont irrémédiablement marqué sa vie, depuis l’attentat manqué du 21 juin 1989 à l’Addaura jusqu’au cratère tragiquement ouvert le 23 mai 1992 à Capaci : un personnage tragique, un homme seul avec l’objectif pointé sur le front, et derrière lui un château de boue et de merde, d’accusations, de poisons, de désavouements publics et privés, de testaments trahis, de loups déguisés en agneaux, de « guépards » comme les a qualifiés avec une admirable capacité de synthèse le procureur antimafia Nicola Gratteri justement chez le même Maurizio Costanzo, pour le trentième anniversaire de l’attentat.
Ce ne sont pas les 1 000 kg d’explosifs placés dans la conduite d’eau sous l’autoroute entre Palerme et Punta Raisi qui ont tué le juge Falcone, mais la solitude. Lui l’avait compris. Il y a cette phrase, sinistre et prophétique, que le magistrat confia à la journaliste française Marcelle Padovani et qui sortira deux mois après l’interview chez Maurizio Costanzo. Elle dit ceci : « On meurt généralement parce que l’on est seul ou parce que l’on est entré dans un jeu qui est trop grand pour nous. On meurt souvent parce qu’on ne dispose pas des alliances nécessaires, parce qu’on n’est pas soutenu. En Sicile, la mafia frappe les serviteurs de l’État que l’État n’est pas parvenu à protéger ».
Ce n’est pas une déclaration, c’est son testament.
Il est difficile pour un Italien, et plus encore pour un Français, de faire coïncider l’image pieuse du héros transcendant qui a donné son nom à des rues, des bâtiments et des pièces de monnaie, avec cet homme de chair, de sang et de fragilité tellement humaine qui avait contre lui, à cheval sur les années 1991 et 1992, les trois quarts des juges italiens et de vastes pans du Conseil Supérieur de la Magistrature. Officiellement, la raison était la naissance imminente de la Superprocura autant souhaitée par Falcone et Martelli que honnie par l’Association Nationale des Magistrats. Ce que Falcone avait compris, c’est que la Direction Nationale Antimafia, définitivement approuvée par décret le 16 novembre 1991, était la seule structure en mesure de donner aux magistrats le pouvoir nécessaire pour lutter contre la mafia qui s’était infiltrée, au cours de ces années, dans tous les centres névralgiques de la vie politique et sociale du pays. Et les faits, au cours des deux décennies suivantes, allaient se charger de lui donner raison. Falcone était un visionnaire. Il voyait des choses que Galasso et d’autres ne soupçonnaient même pas. Il venait tout juste de boucler la boucle et il se préparait à reprendre son rôle de magistrat. Il le souhaitait tellement qu’au début de sa dernière année de vie, il avait candidaté pour diriger l’organe qu’il était si difficilement parvenu à créer.
Après un premier échec en février, au mois de mai les temps semblaient mûrs. Et c’est ici, à ce moment précis, le samedi 16 mai 1992, par une chaude soirée napolitaine, que les destins de Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, déjà solidement liés, s’entremêleront comme des lianes autour d’un arbre, et que l’histoire de l’Italie changera son cours pour toujours. Ce soir du mois de mai, tandis qu’il se promenait sur le front de mer de Santa Lucia, Borsellino reçut d’un collègue l’information selon laquelle Falcone avait désormais la majorité au CSM et se préparait à être nommé Superprocureur. Tout le monde le savait, beaucoup le craignaient et certains étaient prêts à tout pour le lui interdire. Paolo Borsellino lui-même le répètera à la bibliothèque municipale de Palerme, le 25 juin de la même année, un mois après l’attentat de Capaci et 24 jours avant celui de la via D’Amelio dans lequel il perdra la vie. Ce fut un discours mémorable dans lequel non seulement il traça le fil rouge qui conduisit à la mort de son ami Giovanni, mais il signa aussi, sans en avoir complètement conscience, sa propre fin.
« On ne peut pas nier », dit-il, « que Giovanni Falcone, au cours de sa brève, et même très brève expérience ministérielle, travailla surtout pour revenir au plus tôt exercer sa fonction de magistrat. C’est ce qui lui a été interdit. Parce que c’est ce qui faisait peur. »
Ce furent des jours frénétiques. Paolo Borsellino était pressé, il filait, il ne s’arrêtait jamais. Il enquêtait sans cesse, seul, sur la mort de son ami. Il avait pressenti que les mafieux de Corleone avaient actionné la télécommande, mais que celui qui la leur avait mise entre les mains était très loin de là, en costume et cravate, invisible dans ces mêmes palais que Falcone avait tenté de changer de l’intérieur.
Borsellino notait de façon obsessionnelle tous ses rendez-vous quotidiens dans un agenda gris, mais il en possédait aussi un autre, de couleur rouge, sur lequel il avait commencé à écrire le jour qui a suivi Capaci : des notes et des textes plus personnels, qui disparaîtra de sa voiture à la même vitesse que celle à laquelle son corps sauta en l’air dans l’attentat de la via D’Amelio, le 19 juillet 1992. Borsellino était depuis des années dans le viseur des boss, mais – comme le révéla en 2001 le « super » collaborateur de justice Giovanni Brusca aussi appelé scannacristiani [l’égorgeur de chrétiens] – « le projet subit une accélération soudaine après l’attentat de Capaci. » La raison ? Parce que Borsellino était resté le seul véritable obstacle à la négociation entre les Corléonais de Totò Riina et certaines franges de l’État. De l’agenda rouge, plus personne ne sut rien. Disparu, dissout dans un brouillard de mystères et fausses pistes, et avec lui les secrets qu’il contenait entre ses pages. Ce qu’il reste au milieu de la tôle tordue, de l’odeur d’essence et de chair brûlée, c’est le souvenir inéluctable de ce que nous avons été et de ce que nous avons cessé d’être l’instant d’après. Chacun se rappelle exactement où il était, ce qu’il faisait et avec qui à 16h59 ce 19 juillet 1992, avec une exactitude plus évidente encore que lors de l’attentat de Capaci, parce que ce jour fut celui où nous avons compris que nous étions en guerre, mais personne ne savait exactement quel était l’ennemi à combattre. Aujourd’hui, à 30 ans exactement des attentats de la mafia, tandis que nous célébrons nos martyrs avec la même stupide et hypocrite parade de phrases de circonstances et lasses liturgies, la guerre est finie, mais de nombreux ennemis sont encore sans visage et les « héros », privés de la seule plaque digne de ce nom : la vérité.
Lorenzo Tosa, 35 anni, giornalista professionista, grafomane seriale, collabora con diverse testate nazionali scrivendo di politica, cultura, comunicazione, Europa. Crede nel progresso in piena epoca della paura. Ai diritti nell’epoca dei rovesci. “Generazione Antigone” è il suo blog.