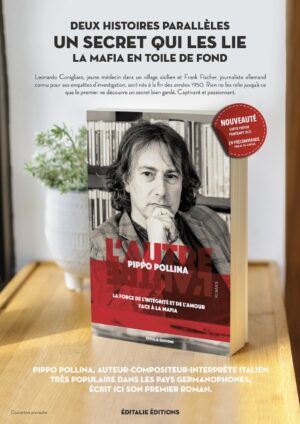De nombreux Italiens appellent désormais la Rai, TeleMeloni. La droite a placé ses hommes aux postes clés de l’audiovisuel public. Présidents, directeurs de journaux… Les nouveaux venus sont ouvertement de droite et n’ont pas toujours l’expérience de la télévision. La droite souverainiste italienne n’a aucun complexe et Giorgia Meloni a clairement affirmé qu’elle voulait « libérer » le secteur culturel du « pouvoir intolérant de la gauche ».
LORENZO TOSA
Un jour, alors qu’elle était au sommet de son pouvoir, la Première ministre britannique Margaret Thatcher était interrogée sur ce qu’elle pensait des attaques fréquentes à son encontre de la part de la BBC. Elle réfléchit un instant et déclara : « Je sais que la BBC m’attaque, mais je ne peux rien y faire ».
Malgré toutes ses contradictions, la Dame de fer a traduit en quelques mots la conception d’un service public indépendant et autonome de la politique, donc non contrôlable. Une leçon que personne, sous nos latitudes, n’a jamais pris la peine d’apprendre, mais qui semble aujourd’hui en 2024, sous le gouvernement Meloni, qui exerce un contrôle absolu et parfois répressif sur la RAI, tout simplement lunaire. Certains l’ont même rebaptisée TeleMeloni, et il est inutile d’expliquer pourquoi.
Une question surgit alors spontanément : s’agit-il d’un problème exclusivement italien ? Sommes-nous une anomalie ou le contrôle de la radiodiffusion publique est-il une caractéristique propre à l’ensemble de l’Europe continentale ?
En Allemagne, la télévision publique est entièrement gérée par l’État, par l’intermédiaire d’une assemblée dont les membres représentent différents organes et niveaux, mais seulement un tiers d’entre eux sont l’expression directe de la politique, ce qui exclut qu’un parti ou une coalition puisse avoir la majorité.
En Espagne, après presque quarante ans de régime franquiste, le conseil d’administration de RTVE, le principal groupe de radiodiffusion publique, a publié en juillet 1981 un document qui stipule, entre autres, la séparation nette entre l’information et l’opinion. Traduction ? Des faits séparés de l’opinion, donc peu ou pas de place pour l’ingérence politique du gouvernement en place.
Et en France ? De toutes les grandes démocraties européennes, la française est celle qui ressemble le plus au modèle italien. Dans les années 1980, elle est passée d’un monopole d’État à un mélange de privé et de public. Mais ici, personne ne songerait à s’approprier le service public et l’indépendance de l’information reste l’un des fondements non négociables sur lesquels les politiques se gardent bien de mettre la main.
La comparaison avec l’Italie, en somme, est impitoyable mais pas surprenante dans un pays où le partage systématique des trois chaînes publiques entre les partis politiques non seulement n’indigne pas et ne suscite aucune protestation, mais où il est même considéré comme une prérogative de la majorité en place qui, dès le lendemain des élections, se sent légitimée à transformer la RAI en son propre fief à coloniser et à soumettre à sa propre propagande.
Pour en comprendre les raisons, il faut remonter près d’un siècle en arrière, en 1927 pour être précis, lorsque Benito Mussolini inaugura l’EIAR (Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche) de l’époque et plaça à la vice-présidence rien de moins que son frère Arnaldo, histoire de bien faire comprendre le climat d’alors. Avec la fin du Ventennio et la chute du fascisme, on aurait pu s’attendre à un changement de cap. Il n’en fut rien, en 1952, le président de la République Luigi Einaudi renouvela la concession exclusive des fréquences publiques à l’EIAR, devenue entre-temps la RAI, en confiant au gouvernement démocrate-chrétien en place la nomination de six membres du conseil d’administration, en plus du président et de l’administrateur délégué, dont le plan triennal était soumis à autorisation ministérielle. Pour voir apparaître une première forme de pluralisme, du moins déguisée, il faudra attendre 1975 et la première loi organique du secteur, la loi 103/75, par laquelle le contrôle de la télévision publique passa formellement du gouvernement au Parlement par l’intermédiaire de la Commission de surveillance de la RAI.
Une feuille de vigne, ou guère plus. En réalité, dans les rôles clés, la majorité resta fermement entre les mains de l’exécutif en place. À partir de ce moment-là, compte tenu également de l’influence croissante des partis de gauche, le partage des chaînes entre les partis politiques devint un système, puis un mot d’ordre, selon un schéma qui n’a pratiquement pas changé jusqu’à aujourd’hui. Ce sont les années de la fameuse pax televisiva et de la tripartition des chaînes publiques : Rai1 aux démocrates-chrétiens, Rai2 aux socialistes et Rai3, alors surnommée TeleKabul, aux communistes. Ce sont aussi les années de la purge historique de Beppe Grillo sous le gouvernement Craxi, à la suite d’une boutade de l’humoriste génois sur la scène de Sanremo à propos des socialistes.
Puis éclata le scandale Tangentopoli qui balaya la première République et pratiquement tous les partis qui l’avaient dominée, marquant l’avènement du berlusconisme et d’un bipolarisme plus dans les intentions que dans les faits. La victoire de Silvio Berlusconi aux élections de 1994 marqua le début d’une anomalie qui a peu d’équivalents dans le monde démocratique. Un seul homme possédait en même temps six chaînes de télévision : les trois chaînes privées historiques (Italia 1, Canale 5 et Rete 4) auxquelles s’ajoutaient les trois chaînes publiques. Cela ne dura pas longtemps : le premier gouvernement de Berlusconi tomba suite à un avis d’ouverture d’enquête et à la « trahison » de la Lega d’Umberto Bossi. Mais quand le Cavaliere revint au Palazzo Chigi en 2001, cette fois avec une majorité plus solide, il le fit avec l’intention précise de prendre le pays en main, et la première pièce était précisément la RAI. Ceux qui, comme moi, ont vécu ces années de près ne peuvent pas ne pas se souvenir du 18 avril 2002, lorsque, depuis Sofia, où il était en visite officielle, le Premier ministre promulgua ce qui restera dans l’histoire comme l’editto bulgaro, limogeant de fait trois de ses plus féroces critiques : les journalistes Enzo Biagi et Michele Santoro et l’humoriste Daniele Luttazzi.
Plus de 20 ans se sont écoulés depuis ce jour noir pour la liberté d’expression, onze gouvernements se sont succédés entre-temps, Berlusconi est décédé en 2023, et nous avons assisté à de nombreux editti plus ou moins déguisés, le plus marquant en 2016 avec l’éviction du journaliste Massimo Giannini, désapprouvé par le gouvernement Renzi.
La vérité est que partage de la RAI entre les partis politiques a toujours été une question bipartite. Pourtant, même ceux qui ont connu de près la saison de Berlusconi et du renzisme n’ont jamais rien vu de comparable à ce qui se passe aujourd’hui dans la nouvelle Rai souverainiste : trois journaux télévisés sur trois en ligne avec le gouvernement, des présentateurs et des journalistes écoutés par des millions de téléspectateurs et dont les parts de marché sont à deux chiffres contraints d’émigrer ailleurs, de Fabio Fazio à Lucia Annunziata, de Luciana Littizzetto à Corrado Augias, en passant même par Amadeus, dont le festival de Sanremo à l’audience record a été jugé trop « de gauche ». Et puis le couperet de la censure s’est abattu sur les intellectuels et les écrivains : l’émission de Roberto Saviano sur les mafias, qui était prête, a soudain disparu des grilles de programmes sans explication, pour y revenir par la petite porte il y a quelques semaines à la suite de protestations ; le discours d’Antonio Scurati a été officiellement annulé par RAI3 pour une banale question de cachet, mais en réalité pour son contenu qui déplaisait aux responsables pro-Meloni, à savoir la reconstitution détaillée de l’assassinat de Giacomo Matteotti par les fascistes, à l’occasion de la fête de la Libération le 25 avril. Au milieu de tout cela, une série de grèves comme on n’en avait pas vues depuis des décennies et l’Usigrai (le syndicat des journalistes de la RAI) sur les barricades parce que – disait textuellement une note – « le contrôle de la direction sur l’information devient de jour en jour plus asphyxiant ».
Au fond, toutes les pièces de ce puzzle nous ramènent en arrière dans le temps, exactement là où cette histoire avait débuté, à un régime qui disposait de la radio comme un prolongement naturel de sa propagande. Ce même régime dont le parti de la Première ministre Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, est l’héritier direct, et dont ni Meloni ni la deuxième plus haute fonction de l’État, le président du Sénat Ignazio La Russa, n’ont jamais réussi à s’affranchir avec des mots clairs et incontestablement antifascistes. Plus que devant une RAI souverainiste, nous sommes face à une fascisation en cours des médias, où le fascisme ne reviendra plus couvert d’un fez et d’une chemise noire, mais sous la forme d’un contrôle absolu et répressif des médias. Mussolini l’a fait avec la radio, Meloni le fait avec la télévision, avec une fureur et une avidité que même Berlusconi n’avait jamais osé atteindre. Et ce n’est que le début.
L.T.
Lorenzo Tosa, 35 anni, giornalista professionista, grafomane seriale, collabora con diverse testate nazionali scrivendo di politica, cultura, comunicazione, Europa. Crede nel progresso in piena epoca della paura. Ai diritti nell’epoca dei rovesci. “Generazione Antigone” è il suo blog.