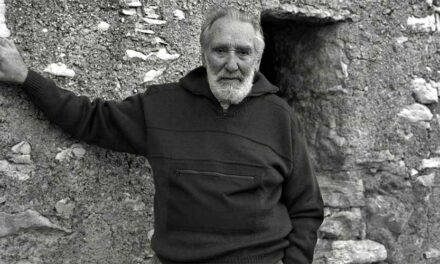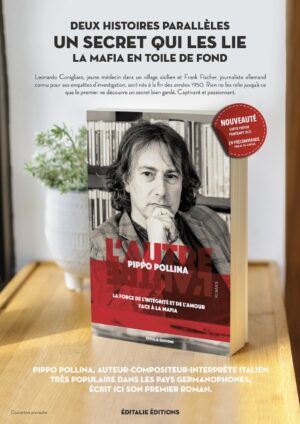À un ami qui venait se plaindre auprès de lui d’un complot qui se serait monté à son encontre, ami qui en outre lui demandait conseil, Bernard Shaw (à moins que ce ne soit Oscar Wilde) aurait répondu : « Joignez-vous aux comploteurs ». Maria Giovanna Cogliandro, dans son passionnant historique de la satire en Italie, publié dans le dernier numéro de la revue RADICI, conclut sur la difficulté qu’il y a aujourd’hui à pratiquer cet art, pour la raison que, depuis Berlusconi, les responsables politiques se sont attelés avec zèle et efficacité à désacraliser la politique.
D’une certaine manière, ils ont rejoint les comploteurs. Nous avons toutes et tous pu l’expérimenter, et dès la cour d’école primaire : quand on est l’objet de moqueries, une façon de les faire s’éteindre est de s’en « servir à soi-même », comme Cyrano de Bergerac. « Oh là, jeune homme, c’est un peu court ! » C’est que la satire et l’ironie sont la reconnaissance d’une force que l’on veut combattre, tout comme l’humour est l’élégance de la faiblesse et de la fragilité.
Mais que devient cette force ennemie lorsqu’à elle-même, elle s’inflige moquerie et désacralisation ? On le voit avec Trump, qui est sans doute l’homme politique qui aura pratiqué avec le plus de détermination et d’envergure cette constante négation de ce qu’un responsable politique doit être – mais il a ses disciples, que ce Boris Johnson ou Matteo Salvini, et bien d’autres. Bien sûr, la satire à l’encontre de Trump existe, tout comme à l’encontre de Johnson ou Salvini ; mais on peut dire qu’elle a toujours un coup de retard. Et quand elle frappe, sa cible est déjà ailleurs, indifférente aux coups. Qui plus est, ces attaques se multiplient lorsque leur cible est ou semble défaite, ce qui ôte à la satire une de ces composantes essentielles : le courage. À moquer sans péril, on triomphe sans gloire…
Ne s’agit-il que d’une stratégie particulièrement efficace de ces monstres politiques, de ces mâles alpha manipulateurs, pervers narcissiques ? Je ne le pense pas. Le mal est plus profond, même chez des mâles aussi superficiels. Dans son excellent Discours à la Nation[1], Ascanio Celestini décrit, entre autres, la manière dont le discours et les valeurs de la gauche révolutionnaire ont été récupérés, intégrés et détournés par la classe dominante. Quand le mot « projet » remplace celui de « hiérarchie » dans les manuels de management, comme l’analyse Franck Lepage dans ces « conférences gesticulées », il devient impossible de s’opposer à la hiérarchie ; et tant pis si « le projet est justement celui du patron ». Qui se bat contre la hiérarchie s’inscrit dans la lutte des classes et le combat contre les injustices ; qui s’oppose à un projet est un salaud.
La force extraordinaire du capitalisme réside sans doute dans sa plasticité idéologique et sa capacité infinie à tout ingérer, digérer, transformer en source de profit. Au début des années 2000, Dexia Luxembourg, une banque d’affaires, lance une campagne publicitaire avec comme effigie… le Che Guevara, que sans doute bon nombre de nos contemporains prennent aujourd’hui pour un fabricant inspiré de t-shirts. Les jeunes protestataires, de Woodstock aux zadistes, sont des icônes anonymes utilisées pour vendre des jeans. Dans un clip légendaire, Ridley Scott lance le Macintosh en 1984[2] en jouant sur l’imaginaire du roman dystopique d’Orwell, 1984 ; trente-cinq ans plus tard, Apple est devenue une de ces compagnies si puissantes que des pays comme le Danemark ont décidé de leur dédier des ambassadeurs, au même titre que d’autres pays.
Ce capitalisme – que l’on devrait peut-être qualifier d’ultra-capitalisme, qui ne peut s’empêcher de financiariser tout ce qu’il touche – est donc de plus en plus capable de transformer la révolte en argument de vente et en profits. A contrario, il sacralise l’autorité et la sécurité, par le biais éprouvé de la peur. Les pouvoirs autoritaires interdisent la satire, et elle est d’une certaine manière le canari dans la mine démocratique ; tant qu’elle peut « sévir », c’est que les libertés sont encore garanties. C’est ce que Brassens chantait dans une de ses dernières chansons, « Tant qu’il y a des Pyrénées » :
« Frapper le gros Mussolini Même avec un macaroni Le Romain qui jouait à ça Se voyait privé de pizza. […] J’ai conspué Franco la fleur à la guitare Durant pas mal d’années, durant pas d’années Faut dire qu’entre nous deux, simple petit détail Y avait les Pyrénées, y avait les Pyrénées. »
Et ce système qui transforme en or même ce qui l’attaque ajoute aux arguments de la peur le virus du soupçon, comme le conclut Brassens :
« S’engager par les mots, trois couplets un refrain, Par le biais du micro, par le biais du micro, Ça s’fait sur une jambe et ça n’engage à rien, Et peut rapporter gros, et peut rapporter gros. »
S’il n’est plus possible de caricaturer des caricatures, s’il faut compter sur l’effroi, la peur et le soupçon à chaque critique aiguisée d’un des multiples travers du monde malade dans lequel nous vivons, en Italie ou ailleurs, quelle solution reste-t-il ? Dans un monde cloisonné où chacun ne lit que ce qui conforte ses opinions, il est de plus en plus difficile de faire entendre un point de vue contraire auprès de celles et ceux qui sont convaincus d’avoir raison. Guido, dans La vita è bella, pense que l’intelligence et l’humour ont tissé de vrais liens d’amitié avec son client allemand. Quand il le retrouve dans le camp, lui déporté et l’Allemand officier, il nourrit l’espoir fou que ce dernier pourra les sauver, sa famille et lui ; la désillusion n’en est que plus cruelle. L’Allemand s’est – peut-être pour se sauver d’un monde devenu criminel ? – réfugié dans la folie de ses énigmes et, détournement suprême, supplie Guido de l’aider, lui…
Dans les rues de Rome, il reste trois « statues parlantes », vestiges de la Rome antique où le pouvoir était fort, assez fort pour supporter la satire. N’importe qui avait la possibilité d’y déposer des critiques, souvent acerbes. Aujourd’hui, les murs de Facebook prétendent parfois jouer le même rôle, sauf que ne les lisent que celles et ceux qui partagent déjà le même point de vue. Les puissants visés par les attaques s’en moquent, voire y trouvent motif à nourrir leur ego insatiable. Jamais une attaque n’empêchera Salvini et ses semblables de dormir. Au contraire ; peu importe ce que l’on dit d’eux, pour autant que l’on parle d’eux.
Que reste-t-il comme marge de liberté lorsque tout est ainsi perverti ? Lorsque les ridicules se ridiculisent à cœur joie et entraînent dans leur chute ce qui devrait rester sacré ? Lorsque des lois sécuritaires, partout en Europe, réduisent progressivement les libertés d’opinion et d’expression ? Lorsque, repliés dans nos identités microscopiques et susceptibles, nous refusons d’entendre les discours rationnels qui s’opposent à nos certitudes, et sommes incapables d’opposer des discours rationnels aux aberrations complotistes et populistes qui achèvent de saper les fondements de la démocratie ? Peut-être, somme toute, ne reste-t-il justement que la satire… Comme un électrochoc qui nous oblige à ouvrir les yeux et les oreilles. Pour autant que l’intelligence ne soit pas définitivement bâillonnée…
[1] Le public francophone a pu découvrir ce texte grâce à la magnifique interprétation de David Murgia, dont on peut voir un extrait ici : https://vimeo.com/217869774.
[2] Voir ici https://www.youtube.com/watch?v=e1lmZOi9PvU.
Professeur de littérature contemporaine à l'Université catholique de Louvain et d'Histoire des Idées et de Formes Littéraires à l'IHECS, il a écrit de nombreux essais, romans, nouvelles et pièces de théâtre. Il est aussi critique littéraire et chroniqueur ; à ce titre, il a collaboré avec Le Soir, Victoire, et Mint en radio. Depuis 2014, il collabore avec La Première, en tant que chroniqueur dans plusieurs émissions.