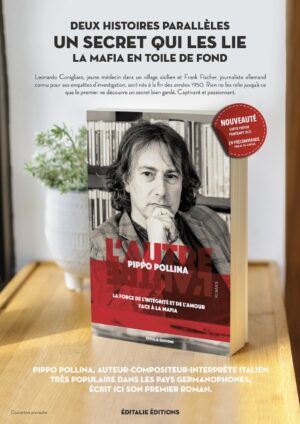C’est toujours dans les moments les plus difficiles de l’histoire que surgissent des personnes qui redonnent sens à la vie et à nos efforts. Des gens simples et exceptionnels en même temps, des personnes qui défendent leurs convictions et luttent pour une Italie meilleure. Les trois témoignages proposés par Lorenzo Tosa, différents et pourtant si semblables, montrent que la solution n’est pas celle d’accepter le destin, mais de vivre l’utopie d’un monde meilleur en l’incarnant par des actions concrètes. Une inspiration pour nous tous.
C’est ainsi que vous devez vous l’imaginer, avec ses creuze étroites où l’on passe tout juste, les rayons de lumière du début de l’automne qui fendent le parvis de l’église paroissiale, les pancartes accrochées aux balustrades en fer battu des balcons « à la ligure » et qui dérangent Dieu et Sainte Catherine avec ce petit grand prêtre qui s’est mis en tête de parler d’amour et de droits.
Son nom est don Giulio, don Giulio Mignani, et cette petite ville s’appelle Bonassola, un amas de maisons et vignes en terrasse à quelques pas des Cinque Terre en Ligurie.
C’est ici que, par un dimanche d’octobre apparemment comme tant d’autres, cinq-cents personnes se sont donné rendez-vous (dans une commune qui dépasse à peine les huit cents habitants) : athées et croyants, fidèles et simples citoyens, associations et compagnons de voyage, unis pour faire entendre leur proximité humaine, physique et spirituelle à ce prêtre « hérétique » et rebelle tout juste suspendu par l’Evêque de La Spezia à cause de ses idées. Don Giulio a eu le tort de prêcher un christianisme laïque dans lequel les droits et la dignité des personnes comptent plus que la doctrine, une Église au sein de laquelle chaque être humain a le droit de renoncer même à sa propre vie quand celle-ci devient indigne d’être vécue, au sein de laquelle bénir les palmes de Pâques n’a pas de sens si l’on refuse la bénédiction à deux hommes qui s’aiment.
Une femme sur la quarantaine vient de suspendre sur la façade de l’église de Santa Caterina d’Alessandria une banderole sur laquelle on peut lire : « Dieu est parti avec que Don Giulio ». Certains prient pour lui, d’autres chantent des hymnes de protestation pour exorciser la peur, les enfants qui, jusqu’à hier encore, servaient la messe, ont les yeux humides et le regard dans le vide de ceux viennent de perdre un père.
Et pourtant il est là, don Giulio. Et il semble porter physiquement sur ses épaules le poids d’une communauté entière qui, année après année, a rempli toujours plus les bancs de cette petite église, tandis que les chambres du dortoir se remplissaient peu à peu de sans-abris, de migrants, des derniers parmi les derniers, parce qu’une paroisse accueille tout le monde, mais vraiment tout le monde, sinon on appelle ça un hôtel.
Tandis que l’on progresse difficilement à travers la foule de visages plus ou moins connus, l’on a la sensation nette que d’ici, de ce petit village de frontière de la riviera ligure, est en train de s’élever une voix de colère et de paix que l’on pourra difficilement ignorer. Ici, devant ce parvis, il y a un peuple en marche, qui traverse toute l’Italie du Nord, enjambe la Padanie des entrepôts industriels, de la « Lega padrona » et du « d’abord le Nord » et arrive jusque dans le salon d’une maison à Trévise, où six jeunes demandeurs d’asile africains ont été accueillis par Antonio Silvio Calò et son épouse Nicoletta Ferrara. Tous deux enseignants, tous deux partisans d’une société qui refuse obstinément de céder à un récit qui veut diviser sur la base de la couleur de la peau. Combien de fois avez-vous lu sur un réseau social ou entendu dans un bar : « mais pourquoi tu ne les prends pas chez toi ? », Antonio et Nicoletta l’on fait, vraiment. En 2016, ils ont adopté six migrants africains, âgés de 19 à 30 ans, qui font depuis lors partie d’une famille élargie comprenant, en plus d’Antonio et Nicoletta, leurs quatre enfants biologiques. Ca n’a pas toujours été facile. Il y a eu des moments où Antonio a eu peur, quand sont arrivées les menaces des néofascistes et que l’on a souhaité à son épouse d’être violée. Il a pourtant continué, sans s’écarter de son chemin. Il ne s’est pas non plus arrêté quand sa maison a été cernée par six drapeaux de l’indépendance de la Vénétie, un pour chacun des ses nouveaux enfants. « Ça a été difficile », admet-il. « Mais en fin de compte ça en valait la peine. Aujourd’hui tous mes enfants travaillent, ils paient des impôts et certains ont décidé de se marier. Si j’ai réussi, moi qui suis enseignant, l’État peut le faire, à plus forte raison. Si on veut, on peut le faire. »
Je me suis souvent demandé ce qu’avaient en commun don Giulio et ces deux êtres humains, au-delà de la rhétorique du bien comme forme de récompense la plus élevée. J’ai fini par me donner la réponse la moins évidente, la plus simple : don Giulio, comme Antonio et Nicoletta, faisaient face à un choix. Ils auraient pu s’accommoder, se plier aux règles écrites ou communément acceptées, aux préjugés ou aux dogmes doctrinaux. Au lieu de cela, ils ont choisi la route la plus longue, la moins fréquentée, ils se sont donné de nouvelles règles, sachant ce qu’ils risquaient. À l’image de modernes Antigones, ils ont défié les lois de l’Église et de l’État et les ont remises en discussion chaque fois qu’un être humain par ces mêmes lois s’est trouvé humilié, discriminé, exclu, chaque fois qu’a été refusé à une personne homosexuelle le droit d’aimer et d’être aimée, chaque fois qu’un homme a été appelé « clandestin ». Ils ont interposé leur corps entre les victimes et les injustices. Rien n’est plus authentiquement chrétien.
Mais alors pourquoi ne parle-t-on jamais d’eux, en dehors d’une poignée d’articles destinés à devenir un bruit de fond entre un pont bombardé à Kiev et les pronostics concernant les ministres du nouveau gouvernement minute par minute ? Pourquoi, pour être encore plus clair, le bien ne fait-il pas la une des journaux ? Je me suis le suis beaucoup demandé ces dernières années pendant lesquelles, sur ma page Facebook, j’ai cherché à réparer cette fracture en racontant le meilleur de ce pays, l’Italie qui résiste, souvent en silence, malgré tout.
Puis, un après-midi d’avril autour de 17h arrive sur mon bureau une nouvelle qui me frappe/trouble/m’interpelle. Pus qu’une nouvelle, c’est une interview qu’un important journal quotidien national adresse à Samantha Cristoforetti qui s’apprête alors, quelques heures plus tard, à retourner dans l’espace, sept ans après la dernière fois, devenant la première femme des équipages de l’Agence Spatiale européenne. Si elle avait été un homme, on lui aurait demandé des détails sur sa mission ou bien sur certaines curiosités technologiques. Mais Cristoforetti est une femme. Qui plus est, la mère de deux enfants. Et alors le journaliste décide de lui poser cette question lunaire (pour rester dans le thème).
« Combien de post-it avez-vous mis sur le frigo, étant donné que vous serez absente pendant cinq mois et que quelqu’un va devoir quoi qu’il arrive gérer la famille à la maison ? »
Elle réfléchit un peu, réprime difficilement sa gêne, puis de ses lèvres se détache une de ces réponses mémorables qui montrent l’exception, en la normalisant.
« J’ai un partenaire, le père de mes enfants, qui s’occupera de gérer la maison comme nos enfants. Il le fait déjà depuis toujours. Ce n’est donc pas un changement si radical. » Une grande leçon qui, cependant, s’éclipse, se perd et se fond en quelques heures dans les centaines, les milliers de commentaires de guerriers du clavier qui reprochent à la plus grande astronaute au monde d’avoir sacrifié ses enfants pour sa carrière, de ne pas être une mère à la hauteur, de n’avoir été que trop dans l’espace, et que, allons, il est l’heure de rentrer à la maison.
Ils continuent ainsi pendant six mois. Samantha Cristoforetti, entretemps, devient la première femme européenne aux commandes de la Station Spatiale Internationale et ici-bas, sous nos latitudes, tout ce qu’on trouve à lui dire, c’est qu’il « n’est pas digne » d’en recevoir les clefs avec les cheveux sens dessus-dessous, qu’une femme ne peut pas se montrer comme ça. Cette fois, cependant, aucune réponse ne viendra, seulement ce sourire franc et droit avec lequel Samantha Cristoforetti parvient à défier jusqu’à l’absence de gravité, si naturelle, si évidente au fond. J’ai alors repensé à don Giulio, à sa communauté en marche, à Antonio et Nicoletta et à leur famille élargie, et, je ne sais pas pourquoi, mais il m’a semblé que Samantha Cristoforetti faisait finalement elle aussi partie de ce pan d’Italie qui ne se contente pas de contester les règles, mais qui les renverse, qui en propose une nouvelle interprétation. Qui a dit qu’une femme ne pouvait pas être astronaute ? Probablement la même personne qui pense qu’un prêtre doit se limiter à dire la messe ou qu’il n’y a pas de famille en dehors des liens du sang ; combien de fois l’avons-nous entendu dire, cela fait peut-être déjà partie de nous et nous ne nous en sommes même pas rendu compte.
C’est pour cela qu’il ne faudrait jamais arrêter de raconter certaines histoires : les vies d’hérétiques illuminés comme don Giulio, de fous idéalistes comme Antonio et Nicoletta, de révolutionnaires comme Samantha Cristoforetti. En définitive, quand on y pense, c’est de cela qu’il s’agit : mettre la barre un peu plus haut. Eduardo Galeano nous l’avait d’ailleurs déjà expliqué en des temps moins suspects : « L’utopie est à l’horizon : je fais deux pas en avant, elle s’éloigne de deux pas. Je fais dix pas de plus, l’horizon s’éloigne de dix pas. À quoi sert l’utopie ? Elle sert à ça : à avancer. »
Lorenzo Tosa, 35 anni, giornalista professionista, grafomane seriale, collabora con diverse testate nazionali scrivendo di politica, cultura, comunicazione, Europa. Crede nel progresso in piena epoca della paura. Ai diritti nell’epoca dei rovesci. “Generazione Antigone” è il suo blog.