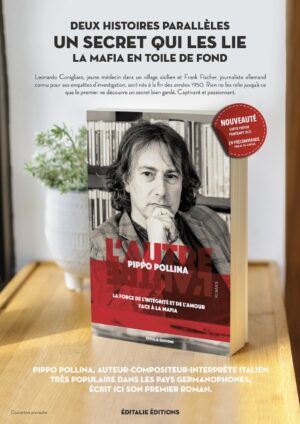Il y a cent ans naissait Italo Calvino : de partisan à auteur de contes pour enfants qui plaisent aux adultes, voici le portrait d’un écrivain « fantastique » qui fut l’un des plus importants de la littérature italienne du XXe siècle.
ALESSANDRO BORELLI
Un critique sévère comme Alberto Arbasino écrivit à son sujet : « Légèreté calvinienne. Un lourd malentendu de notre époque. Italo Calvino n’était pas du tout léger. Il était très sérieux, travailleur, parcimonieux, industrieux, absorbé, concentré, modéré, occupé, calculateur, mesuré, comme tous les meilleurs Liguriens ». C’est dans cette succession d’adjectifs qu’apparaît le portrait de l’un des intellectuels les plus complexes et, à certains égards, les plus incompris du XXe siècle italien. Italo Calvino est né il y a cent ans, le 15 octobre 1923, loin de l’Italie, à Santiago de Las Vegas de La Habana (Cuba), et, par amour de l’Italie, il fut justement baptisé Italo. Sa famille était aisée : sa mère, Eva Mameli Calvino (aucun lien de parenté avec le Goffredo de l’hymne national), fut la première femme à obtenir un poste de professeur d’université en botanique, elle enseigna à Cagliari, mais elle vécut et travailla longtemps, avec sa famille, à Sanremo. Son père, l’agronome Mario Calvino, républicain mazzinien et franc-maçon, se trouva en 1908 au cœur d’une affaire internationale complexe liée à l’attentat manqué contre le tsar Nicolas II en Russie. Dans un premier temps, le responsable désigné fut le « journaliste italien » Mario Calvino ; ce n’est que plus tard que les autorités l’identifièrent en la personne du mathématicien Vsevolod Vladimirovich Lebedincev, un anarchiste qui était rentré en Russie grâce au passeport que Calvino lui-même lui avait volontairement remis en Ligurie, où il l’avait rencontré. Ces événements participèrent à jeter sur le scientifique l’ombre du « dangereux subversif » qui l’accompagna pendant longtemps : comme il l’écrivit, en 1909, les circonstances le poussèrent « à se détacher des terres de mes ancêtres et à traverser l’océan ». Il arriva aux États-Unis, puis au Mexique et enfin à Cuba, où allait naître son fils Italo.
DANS LA SANREMO SNOB
En 1925, retour à Sanremo, la ville d’enfance d’Italo Calvino. Dans un article paru en 1960, l’écrivain l’évoquait ainsi : « J’ai grandi dans une ville très différente du reste de l’Italie […] : San Remo [sic], à l’époque encore peuplée de vieux Anglais, de grands-ducs russes, de personnes excentriques et cosmopolites. Et ma famille était plutôt inhabituelle, à la fois pour San Remo et pour l’Italie de l’époque : des scientifiques, des adorateurs de la nature, des libres penseurs ». L’avènement du fascisme ne sembla pas non plus affecter la routine quotidienne : son père, il est vrai, dut prêter allégeance au Parti national fasciste pour enseigner à l’université de Turin, et même Italo ne put éviter de rejoindre l’Opera Nazionale Balilla au début des années 1930. Mais ce sont ses lectures et ses amitiés qui influencèrent sa formation : il se passionna pour des revues satiriques comme Marc’Aurelio et Bertoldo ; il fréquenta assidûment les salles de cinéma et s’essaya aux premières critiques ; Eugenio Scalfari, futur fondateur du quotidien la Repubblica, son ami de lycée, lui fit connaître les écrivains les plus attentifs aux questions éthiques et sociales, comme Eugenio Montale et Elio Vittorini.
DANS LA RÉSISTANCE
Mais le véritable tournant, pour sa formation politique et culturelle, eut lieu en 1943 : étudiant en agronomie pas particulièrement brillant, après l’armistice du 8 septembre, qui marqua le passage de l’Italie aux côtés des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut contraint de vivre dans la clandestinité pour échapper au recrutement de la République de Salò. En 1944, il rejoignit, avec son frère Floriano, la division partisane des Brigades Garibaldi qui portait le nom de Felice Cascione, un médecin de la ville d’Imperia tué par les fascistes le 27 janvier de cette année-là. Il écrira plus tard : « Derrière le milicien fasciste le plus honnête et de bonne foi, le plus idéaliste, il y avait les rafles, les opérations d’extermination, les chambres de torture, les déportations et l’Holocauste ; derrière le résistant le plus ignorant, le plus escroc, le plus impitoyable, il y avait la lutte pour une société pacifique et démocratique, raisonnablement juste, et non pas absolument juste, car il n’en existe pas de semblable ». Cette expérience, qui le vit, en mars 1945, à l’approche de la Libération, en première ligne lors de la bataille de Bajardo, près d’Imperia, allait aboutir peu après, en 1947, à son premier roman Le sentier des nids d’araignée (Il sentiero dei nidi di ragno), et au recueil de nouvelles Le corbeau vient le dernier (Ultimo viene il corvo), de 1949.
COMMUNISTE SINGULIER
L’expérience partisane déboucha presque inévitablement pour Calvino sur un rapprochement avec le Parti communiste italien, dont il devint militant et cadre quoique, pas un « intellectuel militant » au sens souhaité par le secrétaire de l’époque, Palmiro Togliatti. Au lieu de cela, l’écrivain était attentif, dans le contexte de la république naissante, à des questions telles que les droits, la justice sociale et la liberté. Celles-ci furent le fil conducteur des articles publiés par le quotidien l’Unità – pour lequel il rédigea en 1951 un reportage en Union soviétique, résumé plus tard dans Taccuino di viaggio in Urss d’Italo Calvino – et par le périodique Rinascita. Son style présenta immédiatement des éléments de singularité qui firent dire au poète Marino Moretti : « Parmi mes lectures de ces jours-ci […] il y a eu les trois livres d’Italo Calvino ; un écrivain intéressant qui écrit nerveusement bien sans faire de la prose d’art, communiste mais pas aride et sans l’optimisme stupide des communistes ». Entre-temps, après avoir obtenu son diplôme de littérature à Turin, il débuta, sur les conseils de Cesare Pavese, sa collaboration avec la maison d’édition Einaudi, qui sera fondamentale pour son développement culturel. Progressivement, il rompit avec la dimension plus nettement politique de son œuvre : en lui s’enracinait la conviction que la littérature devait avoir un rôle constructif et rationnel dans ce que Calvino lui-même qualifia, dans un célèbre article publié dans la revue Il Menabò en 1962, de « défi du labyrinthe », face auquel l’intellectuel est appelé à proposer une vision cohérente et organique pour contrer le chaos désordonné de la société moderne.
ADIEU AU PCI
En 1957, il quitta le PCI à la suite, d’une part, de la dénonciation des crimes de Staline par Nikita Khrouchtchev lors du 20e congrès du parti communiste de l’URSS et, d’autre part, de l’invasion de la Hongrie par l’Armée rouge. À partir de ce moment, son angle d’observation changea : bien que toujours sensible aux questions de culture au sein de la société industrialisée, comme en témoigne son travail dans la revue Il Menabò avec Elio Vittorini, en 1959 la veine « fantastique » qui allait caractériser sa poétique se déployait dans Le Vicomte pourfendu (Il visconte dimezzato, 1952), le Baron perché (Il barone rampante, 1957) et Le Chevalier inexistant (Il cavaliere inesistente, 1959), qui forment la trilogie Nos ancêtres (I nostri antenati). Au cours de l’été 1967, Calvino s’installa à Paris avec sa femme Chichita – de son vrai nom Esther Judith Singer, traductrice argentine d’origine juive, épousée à La Havane en 1964 –, et leur fille Giovanna, née en 1965. Il devait y rester cinq ans, pour collaborer avec des intellectuels et des lettrés français ; il y resta treize ans, mais y mena une vie très retirée, tout en fréquentant des intellectuels parisiens de premier plan comme Georges Perec, Jacques Roubaud et Raymond Queneau, dont il traduisit également certaines œuvres.
ÉCLECTIQUE
D’abord influencé par le néoréalisme, puis ouvert au récit fantastique, ensuite expérimentateur subtil, curieux face aux nouvelles frontières de la science, comme cela transparaît dans Cosmicomics (Le Cosmicomiche, 1965), mais jamais désintéressé des questions sociales [de Marcovaldo ou les saisons en ville (Marcovaldo ovvero le stagioni in città) consacré au boom économique de l’Italie, à La Journée d’un scrutateur (La giornata di uno scrutatore, tous deux de 1963], Calvino aboutit, au cours de la dernière phase de sa vie, presque au paradoxe de l’antiroman. Son avant-dernier livre, Si par une nuit d’hiver un voyageur (Se una notte d’inverno un viaggiatore), publié en 1979, est en effet une expérience audacieuse dans laquelle le lecteur est confronté au début de dix romans sans qu’aucun ne soit achevé. C’est cette œuvre qui a conduit la critique à inscrire l’auteur dans le courant du postmodernisme, signe de la capacité de Calvino à être, à chaque étape, un interprète attentif du climat culturel qui lui est contemporain. Auteur prolifique et fécond comme peu d’autres, il a écrit des contes pour enfants, des interviews, des reportages et des essais. Le tout, cependant, en tenant toujours compte – et malgré une veine pessimiste qui marqua la dernière partie de sa production – de la valeur de la littérature comme moyen privilégié pour favoriser une clé de connaissance de la réalité dans toutes ses facettes multiples et contradictoires. […] Italo Calvino est décédé à Sienne le 19 septembre 1985. Leçons américaines (Lezioni americane), publié à titre posthume en 1988, contient les textes des conférences qu’il devait donner à l’université de Harvard au cours de l’année universitaire 1985-1986. Il y nota, entre autres : « Je me suis proposé, dans chacune de ces conférences, de recommander au prochain millénaire une valeur qui me tient à cœur. Telle est, précisément, celle qu’aujourd’hui j’entends recommander : en un temps ou d’autres autres médias triomphent, dotés d’une vitesse très élevée et d’un rayon d’action très étendu, menaçant de réduire toute communication à une croûte uniforme et homogène, la fonction de la littérature est de faire communiquer ce qui est différent avec le différent en tant que tel, sans émousser sa différence, mais en l’exaltant au contraire, conformément à la vocation du langage écrit ».
A.B.