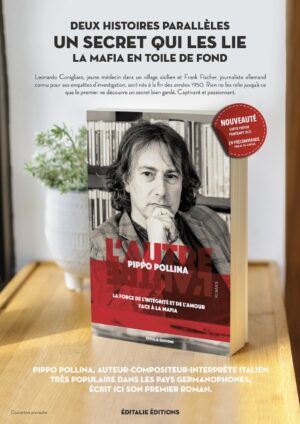Parmi les chantiers de réformes ouverts par Matteo Renzi, deux sont à ses yeux prioritaires et intéressent directement la sphère politique : la loi électorale et la réforme du Sénat. La première, baptisée Italicum, a été adoptée le 4 mai par la Chambre des députés, avec 334 voix pour, 61 contre, 4 abstentions, tandis que les élus des oppositions (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Ligue Nord et Mouvement 5 étoiles) avaient déserté l’hémicycle.
Cette loi, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2016, introduit un mode de scrutin proportionnel, calculé sur une base nationale de cent circonscriptions pour les partis ayant obtenu au moins 3 % des voix, doublé d’une prime majoritaire. Si une formation (ou une coalition de partis) obtient 40 % des voix, elle bénéficiera automatiquement de 55 % des sièges au Parlement. Si ce n’est pas le cas, un second tour sera organisé auquel ne participeront que les deux partis (ou coalitions) arrivés en tête. Le vainqueur obtiendra 53 % des sièges. Réussir la réforme du Sénat et du titre V de la Constitution constitue la prochaine étape du Président du Conseil.
Le 10 mars dernier, la Chambre des députés, par 357 voix sur 630, a adopté un texte. Il prévoit entre autre l’abolition du Sénat actuel, élu au suffrage universel, qui serait remplacé par une assemblée de 100 personnes au lieu de 315, soit 74 conseillers régionaux élus au sein des conseils régionaux, 21 élus par ces mêmes conseils parmi les maires des régions, et 5 nommés par le Président de la République. Ces sénateurs ne recevront pas d’indemnité. Le Sénat aura moins de pouvoir et de prérogatives qu’auparavant: en gros, les principales lois n’auront plus besoin d’être adoptées par les deux Chambres et le gouvernement n’aura pas à solliciter la confiance de cette assemblée.
Pour aboutir, une réforme constitutionnelle doit être votée deux fois dans les mêmes termes par les deux chambres. En première lecture, le texte peut être modifié mais en seconde il est approuvé ou repoussé en bloc. Et si en seconde lecture, il n’y a pas de majorité d’au moins des deux tiers, le texte doit être soumis à référendum. Le long parcours, semé d’obstacles, continue pour Matteo Renzi d’autant qu’il ne dispose pas de majorité réelle au Sénat et que la minorité de son parti lui est hostile. En outre, les résultats des élections régionales et administratives de mai et de juin qui ont marqué un coup d’arrêt à son ascension quasi irrésistible l’obligeront sans doute à faire quelques concessions.
Ces réformes sont importantes, voire décisives. La loi électorale sera rien moins que la troisième depuis 1993, ce qui atteste de l’instabilité politique de l’Italie. Si la réforme du Sénat passe, cela marquerait un changement notable dans la République italienne car le bicaméralisme intégral, une exception italienne en Europe, serait aboli. Ces deux dispositions ont provoqué des échanges extrêmement virulents. Naturellement entre les responsables politiques : l’opposition contre le gouvernement, la minorité du Parti démocrate contre les « renziens ». Mais aussi dans l’espace public. Journalistes, universitaires, notamment les politologues et les constitutionnalistes, ou encore intellectuels ont durement polémiqué et continuent de le faire. Deux thèses s’affrontent.
La première dénonce les risques que comporteraient ces deux réformes. Elles renforceraient considérablement le rôle du Président du Conseil et de son parti qui disposeraient de tous les pouvoirs sans guère de contrepartie. Et par conséquent, elle affaiblirait l’idée et les principes d’une Constitution considérée comme la meilleure du monde. On retrouve là une vieille hantise italienne du pouvoir personnel qui s’ancre dans l’histoire. Laquelle se fonde sur des expériences, de nature différente : le fascisme, les tentatives de modification institutionnelle proposées dans les années 70-80 par le socialiste Bettino Craxi déjà accusé de dérive autoritaire à l’époque par une partie de la gauche, enfin les vingt dernières années où Berlusconi a dominé la vie publique transalpine. Ajoutons que dans ce camp-là, la personne et le style de Matteo Renzi irritent et inquiètent à la fois.
Les partisans de ce dernier expliquent que ce passé est désormais fini, que l’Italie a démontré être démocratique, par exemple, en résistant aux vagues terroristes venues de l’extrême droite et de l’extrême gauche durant les années de plomb, ou encore en ne baissant pas la garde face à Berlusconi. Ils soulignent que la priorité aujourd’hui est de se doter d’un mode de scrutin qui dégage une majorité claire, apte à gouverner pour cinq ans sans un bicaméralisme désuet dont l’existence ne se justifiait que dans le contexte de la sortie du fascisme. Pour eux, une démocratie qui assure « la gouvernabilité » et prend des décisions loin d’affaiblir la démocratie, la renforce et la revigore. En d’autres termes, le débat oppose les partisans de la démocratie parlementaire, où le pouvoir législatif est prédominant, et ceux qui défendent une « démocratie exécutive », marquée par la prééminence du pouvoir exécutif. Un débat qui continuera dans les mois et peut-être les années à venir.
Reste à savoir ce que les Italiens en saisissent. Les enquêtes d’opinion montrent que pour le moment, leurs préoccupations sont autres. Elles concernent le chômage, la croissance de la pauvreté, l’aggravation des inégalités de toute nature, sociales, générationnelles, de genre, territoriales, le sentiment de déclassement qui touche les classes moyennes, l’immigration, le devenir de l’Italie au sein de l’Europe et du monde global, les menaces terroristes des islamistes radicaux. Or ceux qui participent aux controverses virulentes sur les réformes politiques ont la plus grande difficulté à intégrer ces réalités dans leurs prises de position. La politique semble ainsi dissociée du social. Pourtant la légitimité et la crédibilité des institutions politiques se fondent sur leur capacité à être en syntonie avec la société, à répondre aux attentes des citoyens et à favoriser la formation de classes dirigeantes compétentes et méritocratiques. Oui, à cet égard, un long chemin de croix reste à parcourir à l’Italie.
Marc Lazar, Professeur à l’IEP de Paris, spécialiste de la vie politique italienne.
Marc Lazar, né à Paris le 19 juin 1952, ancien élève du lycée Buffon, est un historien et sociologue français du politique. Spécialiste des gauches et de la vie politique italienne, il est depuis 1999 professeur des universités en histoire et sociologie politique à l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris et depuis 2014 directeur du Centre d'histoire de Sciences Po.