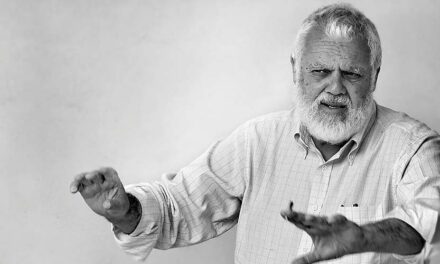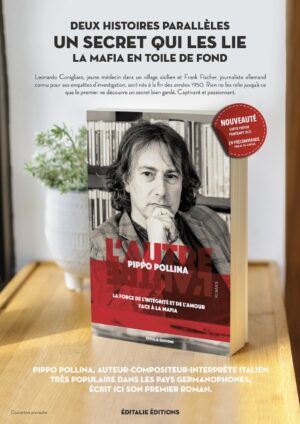Le 2 novembre 1975, le corps sans vie de Pier Paolo Pasolini était découvert sur une plage d’Ostie. À l’occasion des quarante ans de la disparition du poète, écrivain, cinéaste et créateur de génie, RADICI publie un extrait de la lettre que lui écrivit sa grande amie, la journaliste et essayiste Oriana Fallaci, dans laquelle elle rend hommage à cet homme tourmenté.
Oriana Fallaci / L’EUROPEO N°46 – 1975
Rome, le 16 novembre 1975
Je dois avoir quelque part, Pier Paolo, perdue au milieu de feuilles, de journaux, de notes, la lettre que tu m’as écrite il y a un mois. Cette lettre cruelle, impitoyable, dans laquelle tu me frappais avec la même violence que celle avec laquelle ils t’ont tué. Je l’ai emportée avec moi pendant deux ou trois semaines, je lui ai fait faire le tour du monde jusqu’à New York, puis je l’ai mise je ne sais où et je me demande si je la retrouverai un jour. J’espère que non. La voir de nouveau me ferait souffrir autant que lorsque je l’ai lue et que mon sang se glaçait à mesure que je fixais tes mots en espérant pouvoir les oublier. Mais je ne les ai pas oubliés. Je pourrais presque les réciter de mémoire. C’était à peu près cela : « J’ai reçu ton dernier livre. Je te déteste pour l’avoir écrit. Je ne suis pas allé au-delà de la deuxième page. Je ne veux pas le lire, jamais. Je ne veux pas savoir ce qu’il y a à l’intérieur du ventre d’une femme. La maternité me dégoûte. Pardonne-moi, mais ce dégoût, je le porte en moi depuis que je suis enfant, quand j’avais trois ans, me semble-t-il, ou peut-être six, et que j’ai entendu ma mère murmurer que… » Je ne t’ai pas répondu. Que répond-on à un homme qui pleure son désespoir d’être homme, sa douleur d’être né du ventre d’une femme ? Ce n’était pas une lettre adressée à ma personne, du reste, mais à toi-même, à la mort que tu poursuivais depuis toujours pour mettre fin à ta rage d’être venu au monde grâce à un ventre gonflé, à deux jambes écartées, à un cordon ombilical rompu dans le sang. Et comment te consoler, t’apaiser face à une telle inéluctabilité ? Ces mots avec lesquels te consoler étaient justement dans le livre que tu refusais avec colère, le moyen de t’apaiser aurait été de te prendre dans mes bras : de t’aimer comme seule une femme sait aimer un homme. Mais tu n’as jamais permis à une femme de te prendre dans ses bras, de t’aimer. Ce ventre qui est le nôtre, et dont tu es sorti, t’a toujours rempli d’horreur. En dehors de ta mère, que tu vénérais comme une Madone mise enceinte par le Saint Esprit, oubliant que toi aussi tu avais été relié à un cordon ombilical rompu dans le sang, nous, les femmes, t’inspirions physiquement du dégoût. Si tu nous acceptais, c’était par pitié. Si tu nous pardonnais, c’était par volonté. Et tu n’oubliais jamais, de toute façon, la légende qui nous attribuait la responsabilité d’avoir cueilli la pomme, d’avoir découvert le péché. Tu haïssais trop le péché, le sexe qui, pour toi, était un péché.
Tu aimais trop la pureté, la chasteté qui, pour toi, incarnait le salut. Et moins tu trouvais de pureté, plus tu te vengeais en recherchant la saleté, la souffrance, la vulgarité : comme une punition. Exactement comme certains moines se flagellent, tu cherchais la punition dans le sexe qui, pour toi, était un péché. Ce sexe odieux des jeunes hommes au visage dépourvu d’intelligence (toi qui avais le culte de l’intelligence), au corps sans grâce (toi qui avais le culte de la grâce), à l’esprit sans beauté (toi qui avais le culte de la beauté). En eux tu plongeais, tu t’humiliais, tu te perdais : d’autant plus voluptueusement qu’ils étaient infâmes. Tu les chantais dans tes beaux poèmes, tes beaux livres, tes beaux films. Par eux tu rêvais d’être tué, tôt ou tard, pour accomplir ton suicide. Suis-je méchante en te disant cela ? Suis-je cruelle, moi aussi ? Peut-être, mais c’est toi qui m’as enseigné qu’il faut être sincère au risque de sembler méchant, honnête au risque de se révéler cruel, et toujours courageux en disant ce en quoi l’on croit : même si c’est dérangeant, scandaleux, dangereux.
[…]
Je te l’ai avoué un soir. Nous étions devant le Lincoln Center et tu cherchais un taxi pour te rendre dans un endroit que tu ne voulais pas révéler. Impatient, tu semblais inquiet, tu tremblais. Je t’avais murmuré : « Tu vas te faire couper la gorge, Pier Paolo. » Toi, tu m’avais fixée de tes yeux lucides et tristes – ils étaient toujours tristes, tes yeux, même quand tu riais –, puis tu m’avais répondu, ironique : « Tu crois ? » Tu te souviens, n’est-ce pas, de ces journées passées à New York ? Tu venais dans mon appartement, tu t’asseyais dans le vieux divan, tu demandais un Coca-Cola – je ne t’ai jamais vu ivre – et tu me racontais que tu aimais New York parce qu’elle était sale et pervertie. De cette ville extraordinaire, tu ne voyais que la misère morale, d’ancienne colonie, disais-tu, de sous-prolétariat, et une pauvreté que tu comparais à la pauvreté de Calcutta, de Casablanca ou de Bombay. Un après-midi, tu t’es exclamé : « Je regrette de n’être pas venu m’installer ici plus tôt, il y a vingt ou trente ans. Je ne suis jamais tombé amoureux comme ça d’un pays. Sauf de l’Afrique, peut-être. Mais en Afrique, je voudrais y aller et y rester pour ne pas me tuer. Oui, l’Afrique est comme une drogue que l’on prend pour ne pas se tuer. New York, en revanche, est une guerre que l’on mène pour mourir. ».
![]()