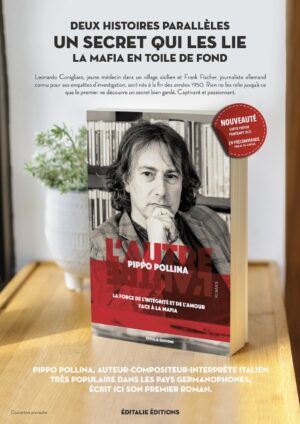Pour un titre qui interpelle, c’en est un ! Je cherche l’Italie. Il y a certains livres qu’on veut lire pour leur titre. Celui-ci fait référence à un autre ouvrage: L’Enéide. Enée, après avoir abandonné Troie en flamme, fait naufrage : il débarque sur une île et ses premiers mots sont pour demander son chemin ; il dit « Italiam quaero », c’est à dire « Je cherche l’Italie ». En règle générale, je goûte peu aux récits de voyages ou autres essais introspectifs sur la découverte personnelle de lieux ou de sensations. Mais il ne faut jamais dire fontaine…Peut-être que ce que Haenel est allé chercher là-bas se rapproche de ma propre quête ?
par Patrick Noviello
Yannick Haenel a vécu quatre ans à Florence entre 2011 et 2014. Il raconte son expérience dans une Italie où il arrive au moment où éclate l’affaire des soirées « Bunga Bunga » de celui qui est encore aux commandes du Pays. Partout dans les villes, aux Unes des kiosques, sont exposées les photos du Cavaliere. « La vulgarité est toujours infernale : Berlusconi souriait. Ce sourire éclaboussait la ville : il proclamait la satisfaction du souilleur ».
Et l’auteur de se dire que « si l’Italie est ruinée, si ça va mal dans ce pays, c’est peut-être parce qu’on y est séquestré dans le ridicule ». Je me souviens alors de ce film où l’un des personnages préfère rester cloitré chez lui tant que Berlusconi est toujours au pouvoir. Mais évidemment, chaque amoureux de l’Italie que nous sommes sait qu’on ne peut réduire la Péninsule à ce dirigeant politique dont on verra bien ce que l’Histoire fera.
Yannick Haenel ne va donc pas s’arrêter là lui aussi. Va-t-il pour autant s’investir d’une mission précise, d’un but ? Non. Ne cherchez pas dans ces pages une leçon, une morale, l’auteur n’ a pas la prétention d’en donner. « Je suis venu m’isoler ici, en Italie, pour échapper à la violence, mais il n’y a rien en dehors de la violence : il est impossible de la combattre, encore moins de la nier ».
Le paradoxe de ceux qui, comme moi, se passionnent pour la chose publique reste de porter un tel amour au pays, qui sans doute plus que d’autres, la confond avec le crime et la corruption. Et pourtant l’auteur explique ce paradoxe le plus simplement du monde : « J’ai longtemps évité la politique. Elle me semblait une passion triste. Il est étrange (peut-être logique) que je m’y sois intéressé de nouveau en vivant dans un pays où précisément, elle mourait ».
Et Haenel de poursuivre plus loin par une mise en garde : « La mort du politique n’est pas qu’un fait ; c’est aussi un poison qui se répand dans les corps et les têtes afin de faire croire qu’à part elle rien n’existe, qu’une seule chose a lieu partout sur la planète, et y règne. » A méditer…
Bien sûr que le politique a une responsabilité et une utilité ! Bien sûr qu’il doit agir prioritairement en certains lieux où se passent des choses plus graves qu’ailleurs pour l’Humanité. Un chapitre s’intitule « Lampedusa ». L’auteur y découvre, au détour d’un article de La Repubblica la mort de trois-cents migrants. « On a retrouvé parmi eux, le cadavre d’une mère et de son nouveau-né encore accroché à elle par le cordon ombilical. L’enfant est né à l’instant même où le bateau a coulé, sa naissance est une mort. » (…) « Lampedusa est devenu le nom de ce qui arrive à ceux qui n’ont plus rien ; et précisément, ceux qui n’ont rien, on ne fera plus jamais rien pour eux ».
Mais au delà de la solidarité et du politique, que reste-t-il alors pour sauver l’humanité si ce n’est le beau, l’esthétisme omniprésent dans le Bel Paese. « Le contraste, l’inadéquation violente entre la ruine d’un pays et la profondeur du renouveau qu’il prodigue à travers ses œuvres d’art est le vrai sujet d’une vie à Florence » confirme l’écrivain. Haenel se décrit ainsi seul face à cette beauté et reconnaît que sa vie « s’accorde à ce pays ruiné, où rien ne semble tenir debout, à part ses cathédrales ».
Quant à son périple, il le résume ainsi : « Au fond, je n’ai fait que ça en Italie : contempler les murs. » N’est-ce pas ce que nous faisons tous, nous qui aimons cette contrée ? Regarder des murs, des œuvres, mais aussi faire des rencontres. Comme ce gérant de café que croise régulièrement l’auteur, « un communiste qui allait à la messe chaque dimanche ». Nous terminerons sur le commentaire humaniste de ce dernier : « Le Kremlin trahit le peuple et le Vatican trahit Dieu. Un vrai communiste aime son prochain ; et un vrai catholique aime les ouvriers ». Voilà l’Italie qu’on cherche.
Je cherche l’Italie
Yannick Haenel,
collection l’Infini, Gallimard.
Patrick Noviello est journaliste à France3 Occitanie. Il enseigne à l’Ecole de Journalisme de Toulouse dont il est issu. Il collabore à Radici depuis 2012. Sa dernière conférence théâtralisée « C’est moi c’est l’Italien » aborde, à travers l’histoire de sa famille, les questions liées aux migrations.