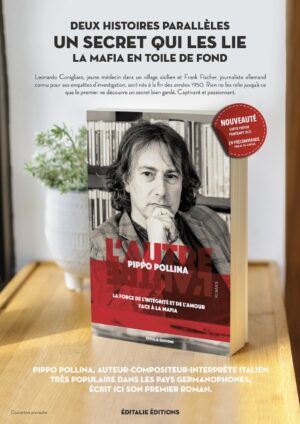Vincent Engel retrouve enfin Venise et confie à RADICI son émotion. Vaporeuse, évanescente, sa beauté est partout : depuis le ghetto jusqu’à la Sacca della Misericordia, en passant par le cimetière de San Michele, nous découvrons dans ses pas une Venise à la saveur particulière, à la lumière et au cadrage inattendus.
En quarante années, je suis allé une vingtaine de fois à Venise. À chaque fois, sauf la première, j’ai pris des photos. D’abord argentiques, puis numériques. Sur certaines de ces photos, j’ai écrit des nouvelles ; d’autres m’ont nourri pour des romans, des pièces de théâtre. Si certains prétendent qu’on « a tous en nous quelque chose de Tennessee », j’ai toujours, depuis 1980, des images de Venise dans ma tête. Ou sur mes murs, mon écran – et je ne parle pas ici des odeurs, des musiques, des sensations, que j’ai évoquées dans une de mes premières chroniques pour RADICI.
En juin dernier, j’y suis retourné. Cela faisait 18 mois que je n’y étais plus allé ; certainement l’aspect le plus pénible pour moi de la pandémie – ce qui prouve au passage que je n’ai pas vraiment souffert, comparé à tant d’autres. Mais j’étais en manque de Venise. Je ne pousserai pas le bouchon jusqu’à déclarer, grandiloquent : « Ne pas voir Venise et mourir ! »… mais quand même.
Professeur de littérature contemporaine à l'Université catholique de Louvain et d'Histoire des Idées et de Formes Littéraires à l'IHECS, il a écrit de nombreux essais, romans, nouvelles et pièces de théâtre. Il est aussi critique littéraire et chroniqueur ; à ce titre, il a collaboré avec Le Soir, Victoire, et Mint en radio. Depuis 2014, il collabore avec La Première, en tant que chroniqueur dans plusieurs émissions.