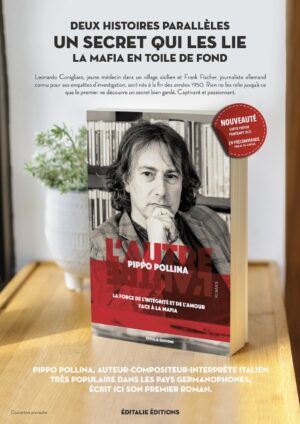L’histoire, éclatée le 11 novembre dernier en Italie, à propos des murs anti-bruit aux abords des autoroutes, qui avaient été « collés à la colle vinylique », est d’une gravité sans précédent. Cette formule, « sans précédent », nous la réitérons à chaque catastrophe, à chaque tragédie, en pensant que l’homme ne peut aller plus bas. Et, chaque fois, la réalité nous montre, de façon impitoyable, notre misère.
Quand on écoute les enregistrements téléphoniques des dirigeants d’Autostrade qui disent : « On a demandé à baisser le niveau de maintenance, plus le temps consacré à l’entretien diminuait, […] donc on distribuait plus de bénéfices », on en a des sueurs froides et, avec les sueurs, une colère et une rage difficiles à canaliser.
L’arrestation, il y a deux jours, des anciens dirigeants d’Autostrade ouvrira une nouvelle guerre judiciaire en Italie. Les années passeront, et qui sait si l’on viendra à bout du labyrinthe de connivences et de responsabilités et, donc, si l’on prononcera une sentence.
En attendant, j’ai vraiment envie de dire une chose de bon sens qui n’a nul besoin de procédure judiciaire.
Le tableau rendu public qui se dégage des journaux est totalement incompatible avec tout type de négociation qui voudrait viser à composer des intérêts totalement opposés.
Il y a, d’un côté, l’État qui a pour mission de protéger et de préserver la vie des citoyens et, de l’autre, une holding disposant de beaucoup de pouvoir (contrôlée par la famille Benetton) et qui vise, sans scrupule aucun, les capitaux sur les profits et les dividendes à partager, même au prix de négliger sciemment les investissements nécessaires à la sécurité des ouvrages qui leur sont confiés. Les tragédies d’Avellino et de Gênes le confirment.
Les juges décideront des délits, mais la politique doit décider de la dignité de l’État. Et la réponse ne peut être qu’une seule : la révocation de la concession attribuée aux Benetton.
C’est une question de dignité, et cela a à voir avec la nature d’un certain capitalisme.
Au gouvernement, aujourd’hui, il y a une coalition de centre-gauche. Si, face à cette situation, la gauche, surtout, ne trouve pas son peuple, nous pourrons faire appel à qui nous voulons, à un génie, au Pape ou à Che Guevara, nous n’arriverons jamais à bout de ce que le pays attend. Mais si devant cette triste page de notre capitalisme sans âme, la politique aura l’instinct d’appeler les choses par leur nom, de renverser la table, d’exiger justice, de crier son indignation et de lutter, alors toutes les divisions du présent serviront à trouver un espace d’action et du sens pour repartir sur de nouvelles bases.
Appeler les choses par leur nom, c’est aussi savoir qu’il existe une manière de concevoir le capitalisme qui est incompatible avec le principe du respect et de la dignité humaine.
Il faut redécouvrir et poser aujourd’hui des actes sans lesquels la politique elle-même se réduit à rien de plus qu’une technique à la limite de l’obscène.
Ce n’est pas seulement l’Histoire, avec le H majuscule, qui nous le rappelle. Les dizaines de morts devraient suffire. Sans quoi, il vaut mieux se cacher dans une ombre existentielle qui ne permet plus à personne de voir à l’œuvre cette misérable classe dirigeante.
Rocco Femia, éditeur et journaliste, a fait des études de droit en Italie puis s’est installé en France où il vit depuis 30 ans.
En 2002 a fondé le magazine RADICI qui continue de diriger.
Il a à son actif plusieurs publications et de nombreuses collaborations avec des journaux italiens et français.
Livres écrits : A cœur ouvert (1994 Nouvelle Cité éditions) Cette Italie qui m'en chante (collectif - 2005 EDITALIE ) Au cœur des racines et des hommes (collectif - 2007 EDITALIE). ITALIENS 150 ans d'émigration en France et ailleurs - 2011 EDITALIE). ITALIENS, quand les émigrés c'était nous (collectif 2013 - Mediabook livre+CD).
Il est aussi producteur de nombreux spectacles de musiques et de théâtre.