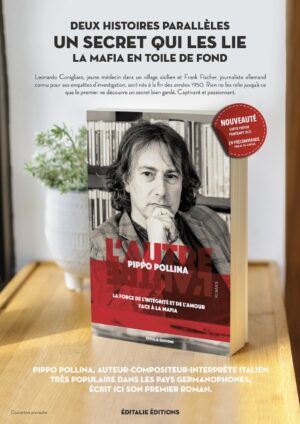L’Italie tout entière devrait être reconnaissante envers Dario Fo qui fête son 90e anniversaire au printemps. Prix Nobel de littérature en 1997 parce que, selon les termes du jury, « dans la tradition des jongleurs médiévaux, il tourne le pouvoir en dérision et rend leur dignité aux opprimés ». Écrivain, metteur en scène, acteur, il fait partie des personnalités les plus grandes, les plus attentives, les plus lucides et les plus vraies de la culture italienne. Nous l’avons rencontré chez lui à l’occasion de la publication de son nouveau roman « Razza di zingaro ».
Le nouveau roman de Dario Fo, Razza di zingaro, édité en Italie par Chiarelettere, est l’histoire d’un champion, à double titre, au niveau sportif d’abord, unanimement reconnu dans le milieu de la boxe allemande, mais aussi pour son humanité. Avec dignité et courage, il a affronté la mort à Auschwitz, déporté en raison de son appartenance à un peuple « inférieur », celui des Tsiganes.
Dario Fo a réalisé cet ouvrage avec la collaboration de Paolo Cagna Ninchi qui s’est chargé des recherches historiques. C’est l’histoire vraie de Johann Rukeli Trollmann, un boxeur sinti de nationalité allemande qui a vécu dans l’Allemagne nazie et trouvé la mort dans cette tragédie qui prend aujourd’hui le nom de Porajmos. Ce terme désigne les persécutions subies dans les camps de concentration par plus de 500 000 hommes et femmes roms et sintis.
De quelle histoire s’agit-il ?
C’est l’histoire d’un grand champion qui avait hérité de la culture des Tziganes – sa race – sa façon d’être, d’agir, d’aborder l’idée de la compétition qui était pour lui complètement différente, naturelle, et qu’il avait appris aux travers des rituels de son peuple, des danses, de la façon de faire de la pantomime, de se mouvoir et de chanter.
Pourquoi la technique de Johann Trollmann vous a-t-elle tant fascinée?
Parce que Trollmann ne combattait pas pour abattre, ni pour être le plus fort, mais pour dérouler un récit, pour montrer au public son agilité, le rythme, l’harmonie ; choses que l’on oublie souvent dans le sport. Le nazisme est né à cette époque, et Trollmann a payé très cher le fait d’être mis de côté, persécuté, et surtout de ne pas être accepté à cause de sa façon de faire sur le ring.
Une technique que vous représentez vous-même dans les dessins qui illustrent le livre.
J’ai tenté de capturer les façons et les attitudes de positionnement du corps, l’approche du jeu de jambes que l’on condamnait alors, parce que l’on considérait comme peu sérieuse, peu « virile », sa façon de se placer face à son concurrent, au point qu’on lui a imposé de ne pas bouger. Une fois, il a perdu parce qu’on lui avait interdit ses pas de danse et la pantomime dans son jeu de combat.
Trollmann n’était pas seulement un boxeur.
Certainement. Trollmann jouait avec son adversaire, il ne le détruisait pas. Il possédait une dimension de rapidité, de rythme, de temps, de gestualité, de souffles et de respiration, et il donnait la possibilité à celui qui était contre lui d’être son partenaire. Être sur scène ensemble. Bien sûr, la technique mise en œuvre était le fruit du travail et de la concentration, mais le modèle était à l’intérieur de lui, parce qu’il était tzigane. Il ne le copiait pas. Si tu n’avais pas une histoire derrière toi, une culture, une origine, ça manquait. Quand Trollmann montait sur le ring, il était accueilli par des sourires parce qu’il jouait pour le plaisir d’inventer et de retrouver une harmonie, le bonheur, l’enchantement du sport. C’est la valeur et le sens d’une société. Et c’est bien cela qui gênait les nazis. Voilà qui était Johann, un homme qui montait sur la scène de la boxe, un homme de théâtre, un danseur. Un homme qui a perdu la vie pour sa dignité, qu’il n’a jamais abandonnée, pas même lors de sa dernière rencontre. Johann était un Tzigane.
Dans votre livre, on perçoit comme une peur qui, depuis toujours, est liée à la notion de « tzigane », la peur de la différence, de la beauté de l’échange, la peur de la confrontation avec la diversité.
Parce que ce n’est pas bien d’utiliser le mot « tsigane ». Dans d’autres civilisations, c’est tout à fait correct, c’est nous qui en avons déformé le sens en y mettant une connotation négative. C’est toujours la recherche de l’ennemi ; « trouve-moi un ennemi et je te donnerai la possibilité de devenir empereur » disait un ancien proverbe romain. Il faut donc chercher des ennemis, à tout prix. Ainsi, on évite d’aborder les problèmes de la vie quotidienne : ne pas trouver de travail, être licencié, fuir à l’étranger quand on est jeune… Trouver quelque chose qui détourne l’attention, s’en tenir à cette clé d’inattention, c’est un jeu permanent.
Souvent, on entend dire que l’exclusion est aussi une conséquence des faits et gestes des Tsiganes qui perpétuent un mode de vie archaïque dans le monde d’aujourd’hui, qu’ils volent, et commettent des actes illégaux…
Je voyage en Europe depuis soixante-cinq ans, j’ai fait des spectacles avec Franca [Franca Rame, comédienne auteur de pièces de théâtre, épouse de Dario Fo, décédée en 2013, ndr] dans le monde entier, même en Chine. Nous avons rencontré des Tsiganes dans les fêtes foraines, vu leurs spectacles, découvert leurs compagnies, et j’ai fait beaucoup de dessins sur eux. J’ai commencé en Espagne où existe une grande conscience de leur culture, et les gens s’en sont appropriés depuis toujours. Il suffit de penser à Picasso et à sa période bleue, qui est dédiée aux Tsiganes. La peur de la différence a toujours existé. Il faudrait comprendre pourquoi leur culture n’a jamais pris chez nous ; ils sont devenus ceux qui « volent les enfants ».
Qu’est-ce qui se cache derrière le fait d’être ceux qui « volent les enfants » ?
Ce ne sont que des lieux communs, certains peuples sont respectés dans toute l’Europe, d’autres se retrouvent dans des situations qui les poussent à fuir…
D’après vous, le monde de la culture italienne fait-il quelque chose pour lutter contre ce genre d’idéologie en cette période de violence xénophobe ?
À mon avis, beaucoup de livres sont spéculatifs, construits sur un double jeu : on prend une personnalité bien connue, en vogue sur les plateaux télévisés, et on lui fait vendre des milliers de copies. Et puis il y a les grands écrivains qui, à grand-peine, arrivent à en vendre mille.
Comment se fait-il que l’on ait tendance à oublier l’holocauste de presque 500 000 roms et sintis ?
Tout ce qui concerne la mémoire passe au second plan si ceux qui ont la responsabilité de la conserver et de la faire connaître meurent. C’est comme ne pas arroser un arbre, ne pas lui donner l’espace nécessaire, ne pas le couvrir quand il gèle, ne pas s’occuper d’un arbre important pour soi, pour sa vie. Alors tout ce qui appartient à la mémoire disparaît, sans comprendre qu’un peuple sans mémoire n’existe pas. Celui qui ne sait pas d’où il vient ne peut savoir où il va…