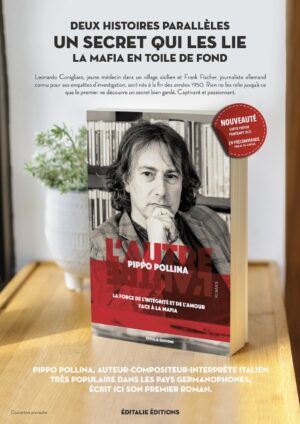Lorenzo Tosa nous parle ici du courage des femmes en s’inspirant de trois héroïnes siciliennes qui se sont rebellées contre la mafia, parfois au prix de leur vie.
C’est un matin de novembre 1992, une de ces journées de vent cinglant qui sent la luzerne et la pluie à peine tombée. Une femme se déplace à pas lents sur le gravier du cimetière de Partanna, à une heure de route de Trapani. Au village, on dit qu’elle est folle, qu’elle a perdu la tête après que son mari Vito et son fils Nicola ont été tués, des histoires de mafia, de vengeance dans la région de Trapani qui, dans ces années-là, ont fait plus de morts que de repentis.
Mais Giovanna Canova n’est pas là pour eux, pas cette fois. De son sac, elle vient de sortir un marteau. Elle le soulève légèrement au-dessus de l’épaule et commence à l’abattre avec acharnement sur la tombe d’une jeune fille de 17 ans, Rita Atria, sa fille, qui s’est suicidée quelques mois plus tôt. La femme est là pour venger « l’honneur » de la famille, pour effacer toute trace de cette fille « dévoyée » qui a brisé le mur de l’omertà et trahi son propre sang. Alors elle frappe. Elle brandit le marteau et frappe une fois, deux fois, cinq fois, dix fois, avec un cri qui semble réveiller les morts, jusqu’à ce qu’il ne reste de cette pierre tombale qu’un tas de marbre en pièces. Une inscription est encore à peine visible, si l’on prend la peine de la reconstituer. On peut y lire : « La vérité vit ». Pas un mot de plus ou de moins ne pourrait mieux raconter la vie et la mort de cette fille extraordinaire qui a bousculé les règles du clan, défié sa famille, le code de la mafia et payé prématurément le prix de son courage.
Lorsqu’un an plus tôt, elle s’était présentée spontanément au parquet de Marsala pour dénoncer les assassins de son frère Nicola, la première personne à l’accueillir avait été un magistrat aux moustaches poivre et sel, une Dunhill constamment à la bouche, qui l’écouta sans la juger, la rassura et l’encouragea à sortir de l’ombre. Ce juge s’appelait Paolo Borsellino. Pendant des mois, Rita a raconté tout ce qu’elle savait, cité des noms et, avec sa belle-sœur Piera Aiello, elle a contribué à faire arrêter des dizaines de mafiosi entre Partanna, Sciacca et Marsala, et à faire ouvrir une enquête sur l’ancien maire de sa ville, Vincenzino Culicchia. Borsellino devint un second père pour elle, peut-être le seul qu’elle n’ait jamais eu. Elle avait même été installée dans un appartement secret à Rome, où Paolo lui rendait visite dès qu’il le pouvait. Cela semblait être le début d’une nouvelle vie, mais un après-midi de juillet, tout a encore changé. Quand, le 19 juillet 1992, une Fiat 126 remplie de TNT a explosé dans la via D’Amelio, tuant sur le coup Paolo Borsellino et les cinq hommes de son escorte, Rita a senti que c’était fini pour elle aussi. Elle a résisté une semaine de plus, puis, le 26 juillet, elle a sauté du sixième étage de l’immeuble de la Via Amelia où elle vivait. Nombreux sont ceux qui ne croient pas au suicide, trop d’ombres, trop de pièces du puzzle qui ne correspondent pas. Quelle que soit la vérité, Rita Atria demeure l’une des femmes qui ont le plus contribué à briser la chape de sang et d’omertà d’une terre, la Sicile, et de sa Partanna, qu’elle a aimée d’un amour absolu et non réciproque. Le jour des funérailles, personne ne s’est présenté à l’enterrement, et en prison les mafiosi ont trinqué à la nouvelle de sa mort. Mais la vérité a survécu à la jeune femme, et même au martèlement de sa mère. Quelques jours avant sa mort, Rita avait écrit ces quelques mots dans son journal : « Peut-être qu’un monde honnête n’existera jamais. Mais qui nous empêche de rêver ? Peut-être que si chacun d’entre nous essaie de changer, nous réussirons ».
Bien des années auparavant, l’une de ses concitoyennes avait également tenté de changer le monde, et contrairement à elle, avait réussi. Elle s’appelait Franca. Franca Viola. Elle aussi, comme Rita, avait 17 ans, le lendemain de Noël 1965, un dimanche, précise le calendrier. Après des semaines de menaces et de pressions en tous genres, son ex-petit ami Filippo Melodia, gangster notoire et neveu d’un chef de gang local, fit irruption chez elle à Alcamo avec treize jeunes hommes armés qui saccagèrent l’appartement, tabassèrent sa mère jusqu’au sang et enlevèrent Franca et son petit frère Mariano, qui s’était accroché aux jambes de sa sœur et ne la lâchait plus. Le frère fut libéré quelques heures plus tard. Pas Franca. Elle passa les sept jours suivants entre une ferme à la campagne et la maison de la sœur de Melodia, sans jamais sortir du lit, sans nourriture, dans un état de semi-conscience, insultée, humiliée et violée à plusieurs reprises par son ex-petit ami. Jusque-ici, il s’agit d’une histoire d’abus ordinaires dans l’Italie et la Sicile archaïques des années 1960. Mais quelque chose se produisit qui allait changer l’histoire de Franca Viola, ainsi que celle de l’Italie. Une fois retrouvée et libérée par la police, Franca refusa, à la stupéfaction générale, le mariage réparateur (qui était alors la norme dans des cas comme celui-ci), elle décida de se déclarer « déshonorée », et elle traîna Melodia devant un juge. Seule avec son père Bernardo, contre l’une des plus puissantes familles mafieuses locales, contre une société patriarcale et rétrograde, contre l’État et ses lacunes législatives flagrantes, elle prononça dans la salle d’audience de Trapani des mots qui firent trembler l’opinion publique farouchement bigote de l’époque.
« Je ne suis la propriété de personne », dit-elle. « Personne ne peut me forcer à aimer une personne que je ne respecte pas. Ce sont ceux qui font certaines choses qui perdent leur honneur, pas ceux qui les subissent. »
Après sept mois de boue, d’insultes publiques et privées et de véritables intimidations, les juges condamnèrent Melodia et ses complices à onze ans de prison, et Franca put épouser un autre homme. Mais il fallut encore quinze ans pour que le mariage de réparation disparaisse du code pénal, de même que le crime d’honneur, en partie grâce au courage et à la dignité inébranlables de cette femme extraordinaire. Quand je pense à l’histoire de Franca, apparaît en filigrane tout ce qui aurait pu se passer pour Rita et qui n’a pas été, dans une sorte de passage de témoin que les explosifs de la Via D’Amelio ont brisé à jamais et, avec lui, toute une génération de Siciliens qui étaient en train de relever la tête.
En cette journée de juillet 1992, à six heures de voiture et de ferry de là, à Petilia Policastro, une poignée de maisons dans les montagnes de la région de Crotone, Lea Garofalo préparait ses derniers bagages avant de partir pour Milan. Elle avait 17 ans, comme Rita. Comme Franca. Elle avait l’âge de l’innocence et une candeur incorruptible. Mais, quand on naît dans une famille et dans un pays de mafia, c’est aussi l’âge des choix irrévocables. Le sien, Lea l’avait fait en ces jours si dramatiques pour l’Italie, mais si radieux pour elle. Au moment où Rita Atria se jetait du sixième étage de son appartement secret à Rome, Lea Garofalo était assise à bord d’un train lancé à 200 kilomètres à l’heure le long de la côte tyrrhénienne en direction de Milan et d’un amour qu’elle croyait pour la vie : celui pour Carlo Cosco, lui aussi fils d’une famille « ndranghetista ». Cela dura peu de temps, à peine quatre ans, juste le temps de donner naissance à la petite Denise. Lorsque, en mai 1996, son frère et son compagnon furent arrêtés, Léa prit leur fille et décida de rompre définitivement tout lien avec ses origines. En 2002, en échange de la protection de l’État pour elle et sa fille, elle trouva également le courage de parler. Pour Denise, elle rêvait d’un destin différent de celui qu’elle avait connu, elle voulait qu’elle fasse des études, car – répétait-elle toujours – « seule l’école peut te faire lever la tête et dire non ». Elle décida alors de collaborer. Elle raconta tout, pendant des années : le trafic de drogue, les vengeances, les meurtres, les affaires des clans. Pourtant, pour l’État, elle continua jusqu’au bout à être considérée non pas comme une témoin de justice, mais comme une collaboratrice. Une repentie, en somme. C’est également pour cette raison qu’en 2009, après une longue série de révélations, Lea Garofalo décida de quitter le programme de protection et de se tourner vers Don Luigi Ciotti et son association anti-mafia « Libera ». Elle eut à peine le temps de dire sa vérité à son avocate, Enza Rando, avant de retourner quelques jours avec sa fille à Milan pour rencontrer son père.
C’est là, dans une maison empruntée pour l’occasion, que Cosco assassina Lea, de sang-froid, avant de transporter son corps à Monza et de le brûler trois jours durant à l’aide de 50 litres d’acide pour qu’il n’en reste aucune trace. Pour ce meurtre brutal, Carlo Cosco a ensuite été arrêté et condamné à la prison à vie avec son frère et ses complices, aboutissement aussi des nombreuses révélations de Lea. Ce n’est que le 19 octobre 2013 que la ville de Milan lui rendit un ultime hommage sur une Piazza Beccaria bondée, avec les mots de sa fille Denise :
« Ma chère maman a eu le courage de se rebeller contre la culture mafieuse, la force de ne pas se plier à la résignation et à l’indifférence. Ses funérailles publiques sont un signe de proximité non seulement avec elle, mais aussi avec toutes les femmes qui ont risqué et continuent de risquer leur vie pour leurs valeurs, pour leur dignité et pour la justice ».
Et les pensées de tous ne pouvaient qu’aller vers Lea, vers Rita et Franca, vers les femmes qui ont donné leur vie au nom de ces valeurs, parfois même leur mort. Sur cette place de Milan, le cycle s’est enfin interrompu, les blessures se sont résorbées, mais les cicatrices restent là, gravées sur la peau, avec toutes les souffrances qu’elles ont engendrées. À nous de transformer la douleur en souvenir.
Lorenzo Tosa, 35 anni, giornalista professionista, grafomane seriale, collabora con diverse testate nazionali scrivendo di politica, cultura, comunicazione, Europa. Crede nel progresso in piena epoca della paura. Ai diritti nell’epoca dei rovesci. “Generazione Antigone” è il suo blog.