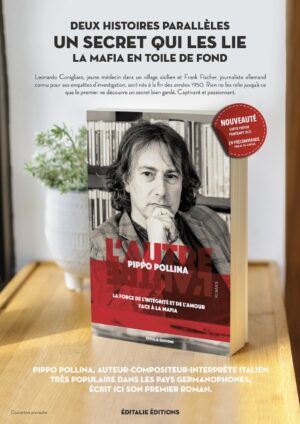Chanteur, poète, écrivain, philosophe : voyage dans la vie et les expérimentations de l’un des artistes les plus polyvalents et militants de l’Italie contemporaine.
La cohérence. Il est étonnant que ce soit justement la cohérence qui définisse les artistes et intellectuels les plus fluctuants, éclectiques et vagabonds que nous avons en Italie. Et pourtant, dans tout ce que tâte et explore Marco Rovelli l’auteur-compositeur-interprète, l’écrivain, le philosophe, l’enseignant, l’on suspecte son geste d’être un geste unique et fondateur, en mesure d’ouvrir des espaces infinis vers l’avenir, la matière première du poète.
54 ans en juin, originaire de Massa, professeur de philosophie en disponibilité, musicien militant, auteur de livres qui ont cherché à comprendre les marges d’un mal-être intime et collectif demeuré dans l’ombre du récit autobiographique d’une nation : les camps de migrants, les morts au travail, les travailleurs journaliers dans les mains des caporali du Sud [terme qui désigne les intermédiaires qui recrutent illégalement des travailleurs agricoles].
Je le rencontre pour la première fois au mois d’avril, sur la scène d’un théâtre parisien de Pigalle, Les Trois Baudets, qui lança dans les années 50 et 60 des chansonniers comme Georges Brassens, Jacques Brel ou Boris Vian, et qui accueille alors le Festival de musique italienne Canzoni & Parole. Il vient tout juste d’envoyer chez l’imprimeur son dernier livre consacré à la souffrance psychique des individus dans la société. Soffro, dunque siamo [Je souffre, donc nous sommes] en est le titre. C’est de là que nous partons pour dérouler la carte d’une géographie artistique qui échappe volontairement à toute étiquette et catalogage.
« Vous savez », me dit-il, « en faisant le tour des librairies, il m’est arrivé de trouver mes livres un peu dans tous les rayons et toutes les catégories possibles. On ne sait pas où me mettre. »
Comment définiriez-vous votre dernier livre ?
Probablement comme un essai, au sens des Essais de Montaigne, qui signifie littéralement essayer, tâter le terrain pour voir s’il est solide. Tâter et, donc, explorer un territoire que je ne connaissais pas encore en 2018, quand j’ai commencé.
Pourquoi un philosophe a-t-il décidé d’écrire un livre que l’on pourrait s’attendre à lire chez un psychologue ?
Pour une raison très simple : parce qu’un livre comme celui-ci n’existait pas encore. Je m’étais rendu compte de la nécessité de lever le couvercle sur un sujet important refoulé par notre société, et en même temps, de le faire dans une perspective différente de la perspective clinique traditionnelle.
Quelles ont été les réactions ?
Surprenantes. Tous les « psys » que j’ai rencontrés ont accueilli ce travail avec beaucoup d’enthousiasme et ils l’ont conseillé à leur tour aux étudiants des écoles de psychothérapie. On ne peut pas dire la même chose des médias, qui l’ont complètement ignoré en dehors de quelques rares exceptions. En réalité, le fait de ne pas être un expert dans ce domaine a été un avantage parce que cela m’a permis d’embrasser la souffrance psychique dans une perspective externe, divulgatrice, sans jamais enlever de rigueur à ce sujet si délicat qui touche la vie, les personnes dans leur chair.
Qu’avez-vous appris en écrivant ce livre ?
J’ai commencé à cartographier ce territoire en 2018, en période pré-Covid. Mais la pandémie, en dépit de ce à quoi l’on aurait pu s’attendre, n’a pas provoqué de grand changement. La pandémie a signifié l’isolement, la perte de relations, elle a ainsi été un grand accélérateur de souffrances psychiques qui étaient déjà au centre du désarroi contemporain, elle n’a rien inventé.
Dans le livre, vous accordez une partie importante à l’enquête sur ce que vous qualifiez de « société de la prestation », dont le contrepoint naturel est l’échec sous toutes ses formes et ses pervertissements.
Au cours de ces trente dernières années, une transformation radicale, non seulement économique mais aussi anthropologique, s’est opérée dans la société : un véritable saut quantique dans lequel le triomphe de l’individualisme, de la compétition et du mythe de l’entrepreneur de soi-même ont tout envahi, déversant les contradictions de la société dans le malheur des gens. Aujourd’hui la perception de l’échec est devenue à tous les niveaux quelque chose d’intolérable, mais l’échec est une expérience fondamentale de l’humain. Il signifie essayer, explorer, expérimenter, alors que la société de Narcisse – comme je la définis dans le livre – nie l’échec parce qu’échouer équivaut à un crash.
Votre expérience d’enseignant vous a-t-elle aidée pour entrer en relation avec la souffrance des jeunes et leurs besoins ?
Beaucoup. J’y ai trouvé non seulement les symptômes clairs du mal-être face à un système qui impose des standards toujours plus élevés et étouffants, mais aussi la forme la plus pure de résistance. Il y a quelques semaines, les jeunes du lycée Manzoni à Milan ont occupé leur école pour une raison à la fois simple et très puissante : « Parce que nous allons mal ». Occuper son école pour protéger sa sérénité psychique : je trouve que c’est un acte politique extraordinaire qui donne la mesure de l’urgence et de la profondeur de ce sujet.
Peppe Voltarelli vous a présenté sur scène comme « l’homme qui chante et écrit en même temps, souvent de façon contemporaine ». Écrivain, musicien, enseignant, poète : quelle identité vous représente le plus ?
Chacune de ces parties est en relation avec une de mes puissances d’agir, comme la définirait Spinoza. Ce sont des expressions de moi différentes et indépendantes, sans que l’une puisse faire abstraction des autres.
Quelle différence y a-t-il entre composer une chanson et écrire un livre ?
C’est un peu comme les cent mètres et un marathon. Tous deux font partie de l’athlétisme, mais ils exigent un développement et un entraînement des muscles complètement différents. Il m’arrive de rédiger une chanson d’un jet, mais elle demande ensuite une phase de réécriture et de post-production très longue, qui est un geste artisanal pas très différent de celui d’écrire et concevoir un livre. L’écriture a ensuite toujours quelque chose d’autopoïétique. C’est un principe d’auto-organisation, c’est le matériau lui-même qui vous suggère comment l’organiser au moment où vous écrivez.
On nous répète depuis années qu’il n’y a plus d’auteurs-compositeurs-interprètes, mais vous semblez plus présent que jamais.
Les auteurs-compositeurs-interprètes n’ont pas disparu, ils sont simplement devenus une niche, avec un public qui leur permet de résister et de survivre. Alors, bien sûr, c’est une question de survie. Et de toute façon pour ma part je ne me suis jamais senti auteur-compositeur-interprète. Avant l’âge de trente ans, je n’ai jamais écouté sérieusement aucun auteur-compositeur italien. Mon cœur est profondément rock, adolescent je voulais être Iggy Pop. Puis j’ai aimé les Velvet Underground, les Sonic Youth (à ce propos, dans mon prochain album j’aurai la chance de collaborer avec le guitariste Lee Rinaldo) et, en Italie, Cccp et Battiato, une sorte de punk mystique.
Faisons un jeu : comment vous vous définiriez comme musicien ?
Je suis un rockeur et je mourrai comme tel, même si dans ma carrière il m’est arrivé d’écrire de tout. Avec « Les Anarchistes », nous réarrangions les chants traditionnels en mode rock-jazz électronique, certains de mes morceaux sont presque de la musique de chambre, tandis qu’ailleurs j’ai revisité les chants populaires toscans. Ma poétique procède par fragments et images, je ne raconte presque jamais une histoire en musique dans le style d’un Guccini ou d’un De André.
Quelqu’un souvent qualifié, lui aussi, de poète.
Par erreur. Non pas pour diminuer son indiscutable valeur, mais parce que du point de vue technique, dans la poésie moderne, il n’y a pas d’expression chantée, ce sont deux expressions artistiques très différentes.
Qui sont les poètes aujourd’hui ?
Ceux qui imaginent des mondes possibles, qui créent des constellations de sens et entrouvrent des passages vers l’avenir, et qui le font avec des mots et des images. Ce sont ceux qui voient là où d’autres ne voient pas, comme Pasolini qui écrit en 1961, dans un poème qui s’appelle Profezia : « Sbarcheranno a Crotone o a Palmi, / a milioni, vestiti di stracci / asiatici e di camicie americane » [Prophétie, « Ils débarqueront à Crotone ou à Palmi,/ par millions, vêtus de haillons / asiatiques et de chemises américaines »] anticipant avec la force prophétique de la poésie les différentes vagues migratoires d’aujourd’hui. Deleuze disait : « Du possible, sinon j’étouffe ». Mais voir le possible signifie aussi le créer, et on ne peut faire cela que dans la relation, tous ensemble, comme j’ai tenté de le synthétiser dans une chanson que j’ai symboliquement intitulée : Noi, Chisciotte.
Une autre histoire très forte que vous avez voulu mettre en musique est celle des guerriers kurdes du Rojava [Kurdistan occidental, ndr], avec lesquels vous avez vécu un temps en contact étroit, que vous avez restituée dans l’album Al confine [À la frontière, ndr].
Ça a été un moment existentiel d’une intensité exceptionnelle. De cette expérience, j’ai emporté la force et la dignité d’une utopie et d’un idéal commun pour lequel combattre. Je me rappelle ce commandant de la résistance de 38 ans retranché dans les montagnes depuis qu’il en avait 18. Nos partisans, dans le pire des cas, y étaient restés 20 mois. Lui, il y était depuis 20 ans.
Qu’est-ce qui l’a poussé et le retient encore là-haut ?
La force de l’utopie et de l’imaginaire. Ici chez nous, être utopiste est considéré comme inutile, presque masochiste, cela revient à être fou ; or, au contraire, en les observant, l’on se rend compte de combien peut être productive la force de l’idéal d’un confédéralisme démocratique dans lequel la démocratie n’est pas uniquement un mot. Dans une chanson, je les ai qualifiés de « Mécréants à la foi immense », et je me sens comme eux.
Qu’est-ce que la spiritualité pour vous ?
C’est un terme insaisissable que nous, Occidentaux, avons du mal à séparer de la religion. Le mot même appartient à la famille lexicale de dieu, une dimension dans laquelle je ne me reconnais pas. La vision métaphysique qui m’est la plus familière est celle de Spinoza et le spinosisme moderne de Deleuze : dieu entendu comme l’être avec ses lois, c’est-à-dire le contraire de la spiritualité fondée sur la transcendance. Paradoxalement, le terme spiritualité revêt son sens le plus fort en opposition au matérialisme brutal et vulgaire de consommation de notre société, à condition, cependant, de ne pas déboucher sur ce qui n’est pas démontrable scientifiquement, autrement la spiritualité devient superstition, position de principe et, comme nous l’avons vu se produire y compris récemment, imposture.
Je ne vous quitte pas sans un mot sur la politique italienne. Sommes-nous vraiment dirigés par des néofascistes ou bien s’agit-il d’une arme de distraction de masse ?
En tant qu’héritiers de cette tradition culturelle précise, je crois que qu’on peut légitimement les qualifier de fascistes. Non pas le fascisme historique mais le fascisme dans son essence conceptuelle, né dans une fonction anti-internationaliste, anti-émancipatrice pour défendre l’identité fermée et retranchée de la triade Dieu-Patrie-Famille. Une nostalgie à laquelle Georgia Meloni a fixé tous les piliers de la société performative et de prestation, parfaitement alignée sur l’époque et pour cela encore plus dangereuse.
Comment en réchapper ?
En imaginant les avenirs possibles, pour finir, on en revient toujours là. Nous avons perdu de vue l’utopie et l’idéal, la force de l’imaginaire, que l’on entrevoit par moment à l’horizon chez les jeunes.
Quelle est votre utopie personnelle ?
La libération de la souffrance. Bien sûr, la souffrance est une dimension consubstantielle à l’humain, mais la conscience parvient à nous émanciper de la souffrance, voilà mon utopie. Et une autre aussi…
Laquelle ?
Quand, en septembre, je retournerai à l’école après mon congé, j’essaierai d’organiser une classe sans notes, jugements ou interrogations. Ce sera ma contribution à une forme réalisée d’utopie. Il faut bien commencer par quelque chose.
Lorenzo Tosa, 35 anni, giornalista professionista, grafomane seriale, collabora con diverse testate nazionali scrivendo di politica, cultura, comunicazione, Europa. Crede nel progresso in piena epoca della paura. Ai diritti nell’epoca dei rovesci. “Generazione Antigone” è il suo blog.