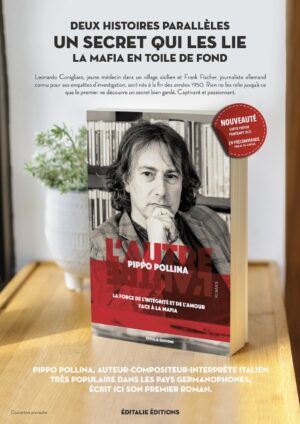C’est une des phrases les plus approximatives qu’il soit pour expliquer la légitimité de la démocratie élective : « Ce que veut le peuple, Dieu le veut ». Je l’ai choisie en raison de la double actualité qui la concerne : l’État italien et l’Église catholique, à travers l’expression d’une volonté dans le choix d’un Pape (la vox Dei ?) et à travers celle, moins évidente mais pas moins réelle du choix, par le peuple italien, d’une classe politique qui puisse enfin gouverner le pays (la vox populi).
Bien que ces deux « voix », au cours de l’histoire, se soient toujours entraidées, se faisant souvent des clins d’œil, je n’ai jamais pensé qu’une vox puisse légitimer l’autre, dans un sens ou dans l’autre. Qui pourrait croire un seul instant que pour la simple raison que c’est le peuple qui choisit, son choix est le meilleur, et encore moins qu’il puisse être ratifié par Dieu ? S’il en était ainsi, qui pourrait prétendre juger comme une anomalie tout italienne (et ça l’est) la présence d’un Berlusconi dans le paysage politique qui est le nôtre ? Cela fait 20 ans que le peuple le choisit et le maintient en vie. Terrible dialectique, donc, que celle de la « vox populi, vox Dei ». Elle n’a que rarement fait du bien, qui plus est à une démocratie saine et mûre, même si c’est le peuple qui choisit. Je me souviens encore de mon grand-père qui, dans ses moments de colère dus à un résultat électoral qui ne le satisfaisait pas pleinement, s’exclamait :
« Peuple aveugle et imbécile ! » Comment lui donner tort.
Les Italiens sont allés aux urnes et ils ont donné au pays un échiquier politique que l’on ne pouvait imaginer plus compliqué, dans un parfait style à la Nanni Moretti : « Continuons à nous faire du mal » (dans le film Bianca). Avec pour complice une loi électorale qui a réduit à néant la démocratie élective (voir RADICI n° 65).
Nous voici donc, au terme des élections, avec trois grands partis, tous minoritaires c’est-à-dire sans réelle majorité, et aucun des trois n’est disposé à se faire confiance, même au sein d’un gouvernement de transition. On est bien loin du laboratoire politique à l’italienne ! C’est d’un véritable casse-tête à l’italienne qu’il s’agit ! Au vu de la situation, il ne nous reste qu’à retourner voter, mais non sans avoir au préalable adopté une nouvelle loi électorale qui, cependant, devrait être adoptée par un nouveau gouvernement qui, au moment même où j’écris cet éditorial, peine à se construire… En somme, le serpent, comme toujours, se mord la queue, alors que l’Italie retourne pour la énième fois à la case départ.
Et puis soudain, voici que de l’autre côté du Tibre, par un beau jour de ce début de printemps, le Saint-Esprit « entre en scène » (pour ainsi dire) – Saint-Esprit qui, quand il s’y met, peut faire très mal –, et il décide, avec la liberté qui le caractérise, de faire coïncider sa vox Dei avec la vox populi. Et que sort-il du chapeau ? Un Pape sud-américain, ce qui, en soi, est déjà une belle avancée si l’on pense au risque qu’aurait encouru l’Église à retrouver un pape italien. Mais, non content de cela, que suggère-t-il au nouveau Pape ? De s’appeler Francesco.
À dire vrai, l’autre côté du Tibre nous avait déjà envoyé un premier signe avec la démission de Ratzinger en personne. Fait rare et même révolutionnaire, dans un monde où il est désormais d’usage de s’accrocher à son fauteuil jusqu’au dernier moment. À contre-courant de cette tendance, Benoît XVI dit : « Non merci, continuer comme ça ne m’intéresse pas », conscient, peut-être, de ne pas avoir accompli grand chose, mais conscient, surtout, de ne plus vouloir avoir affaire à ce pouvoir. Et puis voilà que le nouveau Pape crie haut et fort que le pouvoir est « service », collégialité, corresponsabilité. Qu’être Pape signifie surtout ne se sentir qu’un parmi les nombreux fidèles, le plus influent sans doute, mais toujours une partie du corps, jamais au-dessus.
Terrible métaphore de ce que sont devenus les hommes de pouvoir en Italie, où la misère morale de notre classe politique souligne encore davantage le courage qu’a eu l’Église d’oser le changement. D’un côté, une Église souvent critiquée, à tort ou à raison mais qui, aujourd’hui, comprend l’exigence de changement et, de l’autre, une vieille classe politique italienne, usée, toujours plus éloignée de la société civile et en proie à de continuelles luttes entre les partis qui la composent, partis toujours plus assoiffés de pouvoir et irresponsables. Mais cette fois, personne n’avait pensé au Saint-Esprit qui, dans sa grandeur, parfois, s’énerve et nous donne de retentissantes leçons même, et surtout, à la classe politique italienne.
En ce moment, à Rome, la vox populi répète depuis des jours : « Espérons qu’ils le laissent faire…» Le peuple a du flair. Nous le saurons dans un futur proche. En attendant, Acta est fabula! – La commedia è finita.
Et qui sait si l’on applaudira…
Rocco Femia
Rocco Femia, éditeur et journaliste, a fait des études de droit en Italie puis s’est installé en France où il vit depuis 30 ans.
En 2002 a fondé le magazine RADICI qui continue de diriger.
Il a à son actif plusieurs publications et de nombreuses collaborations avec des journaux italiens et français.
Livres écrits : A cœur ouvert (1994 Nouvelle Cité éditions) Cette Italie qui m'en chante (collectif - 2005 EDITALIE ) Au cœur des racines et des hommes (collectif - 2007 EDITALIE). ITALIENS 150 ans d'émigration en France et ailleurs - 2011 EDITALIE). ITALIENS, quand les émigrés c'était nous (collectif 2013 - Mediabook livre+CD).
Il est aussi producteur de nombreux spectacles de musiques et de théâtre.